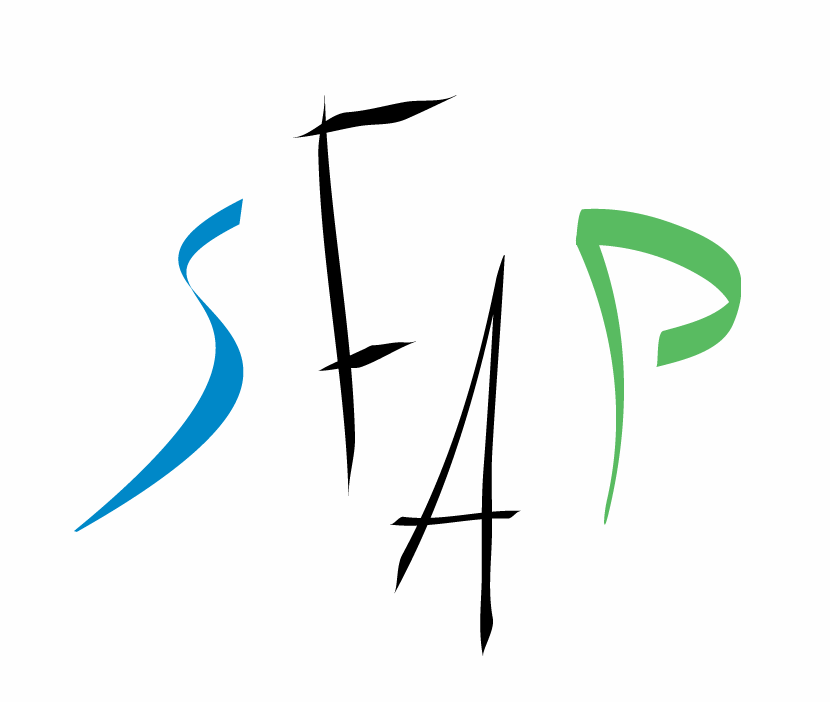
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE
|
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE |
|
� PREMIER CONGRES FRANCO-ALGERIEN DE PSYCHIATRIE
les auteurs qui suivent interviendront lors du congr�s. Vous trouverez ici� une pr�sentation de leurs th�mes de communication.
���
Benjamin Stora
:
"La gangr�ne et l'oubli. La m�moire
de la guerre d'Alg�rie". De 1954 � 1962, quelque deux millions de Fran�ais ont fait la guerre aux Alg�riens. Quarante ans apr�s, cette "guerre sans nom" reste une page blanche de l'histoire nationale. Et le refoulement de sa m�moire continue � ronger comme une gangr�ne les fondements m�me de la soci�t� fran�aise. De l'autre c�t� de la M�diterran�e, un refoulement sym�trique mine la soci�t� alg�rienne: la n�gation par l'histoire officielle de pans entiers de la guerre de lib�ration n'est pas pour rien dans la guerre civile qui d�chire le pays depuis 1992. Pour comprendre les causes de cette double occultation, Benjamin Stora tente, dans cet essai, d'�clairer les m�canismes de fabrication de l'oubli, en France comme en Alg�rie. Il d�montre comment ceux-ci se sont mis en place d�s la guerre elle-m�me: du c�t� fran�ais, c'est la n�gation de l'existence m�me de la guerre, le refus obstin� de reconna�tre la r�alit� de la torture et des ex�cutions sommaires�; du c�t� alg�rien, c'est la violence de la guerre de la guerre civile secr�te qui opposa le FLN et le MNA, ou le massacre en masse des harkis � l'�t� 1962, perp�tr� par les ralli�s de la vingt-cinqui�me heure. L'auteur montre �galement comment les mensonges de la p�riode 1954-1962 seront � leur tour, dans les d�cennies suivantes, enfouis dans les m�moires par les amnisties ou les non-dits d'une histoire �clat�e, telle qu'elle ressort des livres ou des films consacr�s � la guerre. "Benjamin Stora entreprend avec succ�s d'expliquer les raisons de ce non-dit collectif, son livre inaugure un autre regard sur une page d'histoire surcharg�e et mal lisible". Laurent Theis, Le Nouvel Observateur Intervention: France-Alg�rie
: De la m�moire � l'histoire.
���� Claire Mauss-Copeaux : "Appel�s en Alg�rie. La parole confisqu�e." Hachette Litt�ratures, 1998. D�chir�s entre l'impossible oubli et la m�moire impossible de cette "guerre sans nom", les r�cits des appel�s de la guerre d'Alg�rie ont �t� longtemps retenus. Compos�s � partir de leurs t�moignage, ce livre est une contribution majeure � l'histoire de la guerre : comment les appel�s d'Alg�rie ont-ils v�cu ce conflit. les dilemmes moraux de la guerre? Comment voyaient-ils l'arm�e de m�tier ou les Alg�riens? Claire Mauss-Copeaux, agr�g�e d'histoire, est chercheur au CNRS � Lyon et au GREMMO (Groupe de Recherches et d'Etudes sur la M�diterran�e et le Moyen-Orient). Intervention: "Souffrance, m�moires et histoire d'Alg�rie". Les r�cits les plus anciens de l'histoire de l'humanit� font de la guerre l'�v�nement par excellence et d�crivent longuement la souffrance de quelques h�ros exemplaires choisis parmi les combattants. En Occident, en France aussi, l'histoire-bataille, les "grands" �v�nements, b�n�ficient de la faveur des historiens mais leur approche n'est pas un sujet � part enti�re. Dans un premier temps je m'attacherai � pr�ciser les obstacles culturels, sociaux et politiques qui se sont oppos�s et s'opposent encore � l'�vocation et � la prise en compte de la souffrance des combattants. J'�valuerai ensuite les informations que les v�t�rans donnent sur la violence de la guerre, sur les sentiments qu'ils ont �prouv�s ou �prouvent encore aujourd'hui. L'analyse des diff�rentes situations d'�nonciation, du discours lui-m�me avec ses oublis et ses occultations me permettra de compl�ter et d'affiner, pour reprendre l'expression de G. Dum�zil, ces "Heurs et malheurs du guerrier".� Pour conclure, je m'interrogerai sur les implications de ce travail de deuil partag� o� interviennent � la fois la m�moire et l'histoire ainsi que sur les enjeux de la reconnaissance (instrumentalisation de la souffrance et victimisation des combattants)
��� Louis Crocq : "Les traumatismes psychiques de guerre." Editions Odile Jacob Sursauts, angoisse, souvenirs obs�dants, visions hallucin�es, cauchemars, repli sur soi : tels sont les principaux sympt�mes dont souffrent tous ceux qui ont v�cu l'enfer de la guerre. Pour les combattants comme pour les civils se pose la question : peut-on oublier? peut-on gu�rir des violences psychiques de la guerre? Et comment? Parvenir � parler authentiquement de cette indicible exp�rience , n'est-ce pas l'unique solution permettant de l'assumer pleinement et de trouver, enfin, l'apaisement? Louis Crocq a �t� psychiatre des arm�es, professeur associ� de psychologie � l'universit� PARIS-V et pr�sident de la section militaire de l'Association mondiale de psychiatrie. Il a fond� le r�seau de cellules d'urgence m�dico-psychologique qui, dans toute la France et � l'�tranger, dispense les premiers soins aux victimes d'attentats, de catastrophe, de guerres. Intitul� de son intervention : "La fausse m�moire et le syndrome de r�p�tition."
Editions Eres Marie-Odile
Godard,
Ma�tre de Conf�rences � l�Universit� de Picardie - Jules Verne
Le XXe si�cle a �t� marqu� par les
g�nocides et les guerres. Pour survivre et reprendre pied dans leur vie, les
rescap�s de ces drames collectifs ont d� mener un combat solitaire, souvent
inconscient, dont les r�ves sont les t�moins et les sympt�mes. Des ann�es plus
tard, ils revivent � travers leurs cauchemars ce qu'ils ont parfois r�ussi �
oublier le jour. Leurs nuits demeurent � jamais marqu�es du sceau du malheur.
��� Ma�ssa Bey : "Entendez-vous dans les montagnes..." Editions de l'Aube, �ditions Barzakh, 2002 Un train aujourd'hui, quelque part en France.... La narratrice est plong�e dans un livre, dont la lecture va permettre un d�clic : elle retrouve l� le souvenir de son p�re tomb� sous la torture en 57... Le r�cit de Ma�ssa Bey - il lui aura fallu deux ans pour traduire en mots cette part muette de sa vie - est splendide dans sa sobri�t�, la force de son �vocation et l'absence inou�e de haine. Une le�on magistrale, qui la confirme dans son r�le d'�crivain et met en avant son souci constant d'humanit�. Entendez-vous dans les montagnes... est un t�moignage poignant que l'�crivain s'emploie � faire part aux lecteurs. Il s'agit d'une partie de sa vie, de son histoire, de l'histoire de son pays, celle de sa terre d'accueil aussi. Une parcelle de m�moire cach�e, refoul�e, enfouie dans les t�n�bres du silence et des non-dits. Sur une soixantaine de pages, des sentiments de peur, de d�chirement, d'espoir, de nostalgie... se confondent, s'entrem�lent pour donner naissance � un �mouvant r�cit-t�moignage. Une �criture que l'auteur a voulu d�tacher de ses charnelles �motions de haine ou de jugement.� Libert�, 23 octobre 2002 Ma�sa Bey, n�e en 1950 au sud d'Alger, est m�re de quatre enfants et travaille � l'�ducation Nationale dans l'Ouest Alg�rien. Elle a d�j� publi� Au commencement �tait la mer, (Marsa, 1996), Nouvelles d'Alg�rie (Grasset, 1998 - Grand prix de la Soci�t� des gens de lettres) et Cette fille-l� en 2001 aux �ditions de l'Aube, couronn� par le prix Marguerite-Audoux. Intervention :"Les cicatrices de l'histoire": Mon intervention portera sur la difficult� de mettre en mots une sc�ne que l'on n'a pas v�cue mais qui est fondamentale dans la m�moire et l'imaginaire. Ci-joint un passage de ce texte :� "J'ai longtemps, tr�s longtemps h�sit� avant d'�crire, non pas sur la guerre, mais sur ce qui m'appara�t � moi comme un questionnement fondamental : le bouleversement profond, total, irr�m�diable et irr�missible que repr�sente une guerre dans la vie de ceux qui la font, qui la subissent (directement ou indirectement) et qui en portent � jamais les s�quelles, s�quelles qui ne s'effacent pas avec un cessez-le-feu ou des trait�s ou des accords de paix. J'ai longtemps h�sit� parce que je ne voulais pas, qu'� l'instar de beaucoup d'�crivains de mon pays ou d'ailleurs, mon travail d'�criture soit centr� sur la d�ploration et/ou la c�l�bration d'un pass� forc�ment glorieux �lev� au rang de mythe qui d�termine tout le devenir des g�n�rations suivantes. Et c'est peut-�tre plus cela qui m'a pouss�e � revenir sur une part de mon histoire que le d�sir de ne plus diff�rer le moment de la confrontation. Il y a aussi bien entendu un cheminement individuel, une qu�te qui ne peut aboutir que si l'on prend le temps de rassembler tous les fragments qui constituent notre propre histoire. Besoin de comm�moration � au sens de "se souvenir ensemble", d'associer le lecteur au souvenir � besoin d'�lucidation, d'�vocation d'une histoire qui ne serait pas falsifi�e ou d�form�e par la m�moire, par la m�moire des autres, par la mienne aussi. Parce que lorsqu'on veut convoquer les souvenirs, surtout lorsqu'il s'agit de souvenirs d'enfance, on s'aper�oit souvent qu'on a tendance � confondre ce que d'autres nous ont racont� avec ce que nous avons vraiment v�cu. La pr�gnance des images surajout�es fait souvent obstacle � la restitution. Et c'est alors qu'intervient l'imaginaire. Approcher le plus possible, par la re-cr�ation, d'instants que l'on n'a pas v�cus. Mais qui ont forg� tout notre �tre, toute notre conscience du monde. Des images fantasm�es d'une sc�ne "engramm�e" que je n'h�site pas � qualifier de sc�ne primitive. C'est cela que j'ai tent� de faire dans mon dernier livre: "Entendez vous dans les montagnes". Une sorte de reconstitution au sens policier du terme. "
��� Alice Cherki : "Frantz Fanon Portrait." �ditions du Seuil, 2000. L'itin�raire de Frantz Fanon, n� antillais, mort alg�rien, et son t�moignage de psychiatre, d'�crivain, de penseur politiquement engag� reviennent �clairer les d�sordres et les violences d'aujourd'hui. Fanon est mort � 36 ans, � un �ge o� souvent une vie d'homme ne fait que commencer. mais toutes ses mises en garde aux pays colonis�s en voie d'ind�pendance se sont r�v�l�es proph�tiques. De m�me ses r�flexions sur la folie, le racisme, et sur un universalisme confisqu� par les puissants, � peine audibles en son temps, ne cessent de nous atteindre et de nous concerner. L'auteur des Damn�s de la terre a produit une oeuvre "irrecevable". Son propre parcours ne l'�tait pas moins et la mani�re dont il s'interrogeait sur "la culture dite d'origine", sur le regard de l'autre et sur la honte n'a pas toujours �t� reconnue. N�e � Alger d'une famille juive, Alice Cherki a particip� � la lutte pour l'ind�pendance. Psychiatre et psychanalyste, elle est coauteur de deux ouvrages, Retour � Lacan? (Fayard, 1981) et les Juifs d'Alg�rie (�ditions du Scribe, 1987). Elle animera un symposium: "Les enjeux psychiques des silences de l'histoire"
|
|
� |