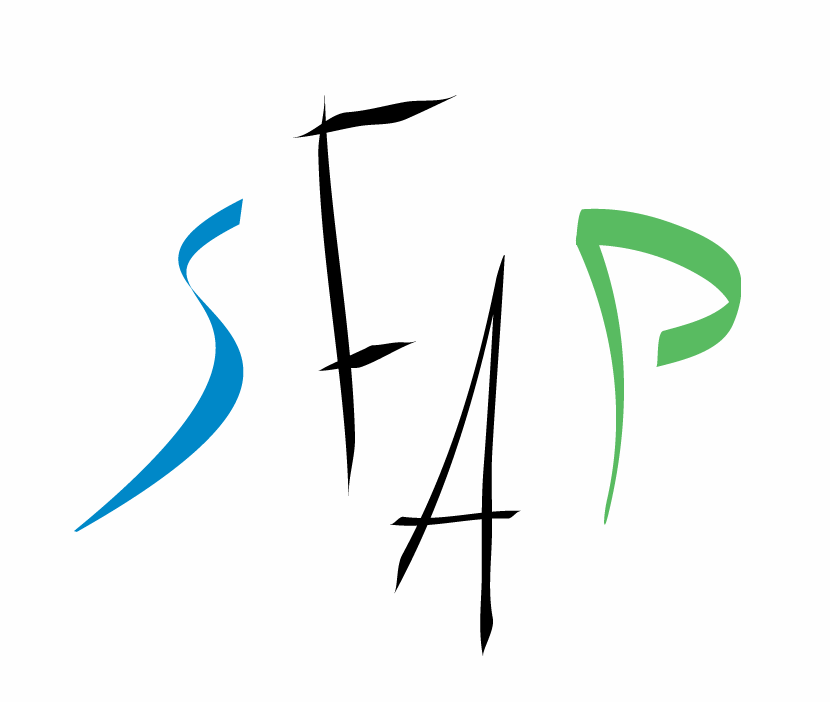
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE
|
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE |
La
m�moire retrouv�e de la guerre d'Alg�rie ?
par
Benjamin Stora, Le Monde, 19 mars 2002
Ceux
et celles qui vont devoir faire et font d�j� l'Alg�rie et la France de demain
n'ont aucune responsabilit� dans l'affrontement d'hier.
Depuis
la mort de Fran�ois Mitterrand, homme politique issu de la p�riode de Vichy et
de la R�sistance, la "g�n�ration alg�rienne" est aux commandes
dans la vie politique fran�aise : ceux qui ont fait la guerre d'Alg�rie, comme
Jacques Chirac ou Jean-Pierre Chev�nement, qui y ont particip�, comme
Jean-Marie Le Pen, ou qui l'ont combattu, comme Lionel Jospin. L'effet de g�n�ration
est important pour comprendre toute l'ampleur des comm�morations li�es au
quaranti�me anniversaire des accords d'Evian. Mais il faut aller plus loin.
Sur
la guerre d'Alg�rie, le passage s'op�re depuis quelques ann�es d'une
sensation d'absence � une sorte de surabondance. Il ne se passe pas un jour, ou
une semaine, sans qu'on d�couvre (ou qu'on feigne de d�couvrir) dans la presse
ou � la t�l�vision un �pisode li� � la guerre d'Alg�rie, une douleur, une
souffrance qui tourne autour de cette p�riode.
Cette
sensation d'absence, que j'avais point�e il y a dix ans dans mon ouvrage La
Gangr�ne et l'Oubli, semble d�pass�e aujourd'hui. L'Alg�rie g�t l� comme
une obsession, il n'est pas possible de l'oublier. La sortie de la d�n�gation,
du silence commence vraiment et, d�sormais, l'oubli obs�de. Cette volont� de
se rem�morer sans cesse l'histoire de la guerre d'Alg�rie envahit l'espace
public. Mais y a-t-il eu vraiment oubli, ou avons-nous assist� plut�t � une
sorte de mise en sc�ne de l'amn�sie fran�aise autour de l'Alg�rie, et de ce
conflit ?
En
fait, au sortir de la guerre d'Alg�rie, apr�s 1962, personne ne se sentait
vraiment responsable ni coupable. Les Europ�ens d'Alg�rie avaient la sensation
tr�s nette d'avoir �t� trahis et abandonn�s par le pouvoir politique. Ils ne
se sentaient pas responsables de la situation coloniale, mais avaient toujours v�cu
l'exp�rience de leur vie en Alg�rie comme des "pionniers" sur une
terre vierge, � d�fricher.
Ils
"oubliaient" le sort in�galitaire r�serv� aux "indig�nes".
Les soldats fran�ais du contingent avaient le sentiment tr�s net de n'�tre
pas les responsables de la situation de guerre. Ils avaient ex�cut� les ordres
de leurs sup�rieurs, et se trouvaient pris dans un engrenage. Les officiers
fran�ais de la guerre d'Alg�rie affirmaient avoir simplement ob�i aux
pouvoirs politiques. Ils "oubliaient" les importants pouvoirs
politiques dont ils disposaient, notamment au moment de la fameuse
"bataille d'Alger" en 1957. Les harkis �galement, ces soldats
musulmans suppl�tifs qui ont combattu aux c�t�s de l'arm�e fran�aise, ont
�t� abandonn�s. Ils ont �t� massacr�s, et ne pouvaient pas se sentir
responsables.
Et
la classe politique fran�aise ? La majorit� de la droite politique
reconnaissait en de Gaulle son "sauveur", reconstituant apr�s 1962 un
consensus politique autour de sa personne pour faire oublier son attitude en
faveur de l'Alg�rie fran�aise. La gauche �galement reconsid�re son histoire
puisque elle avait approuv� les "pouvoirs sp�ciaux" en mars 1956,
dispositions envoyant le contingent en Alg�rie. Jusqu'en 1960, la gauche fran�aise
�tait pour "la paix en Alg�rie". Elle ne se prononcera pour l'ind�pendance
que tardivement. Elle aussi reconstruira un r�cit mythologique li� � la
question de l'ind�pendance de l'Alg�rie, peut-�tre pour faire oublier sa
position ant�rieure. Celle d'une attitude classiquement jacobine, pour l'am�lioration
des conditions de vie des "indig�nes" dans les colonies.
Lorsque
la guerre se termine, personne n'est responsable. Et les soldats, les
pieds-noirs, les harkis, tous se consid�rent comme des victimes. La mise en sc�ne
de l'amn�sie accompagne le processus de victimisation, pour �viter d'�voquer
toute culpabilit� personnelle et �tatique sur l'Alg�rie et la guerre. Le
statut de victime se renforce dans les ann�es 1980 o� il vaut mieux appara�tre
en victime qu'en combattant ou en militant. Les plaintes en nombre pour
"crimes contre l'humanit�" s'inscrivent dans cette tendance. Autre
explication de l'oubli, la blessure du sentiment national. La fin de l'Alg�rie
fran�aise d�veloppe un sentiment tr�s fort de l'amputation d'une partie du
territoire national. "L'Alg�rie, c'�tait la France." Le conflit s'�labore
comme une sorte de guerre civile franco-fran�aise, o� semble se jouer l'avenir
tragique du pays. L'ind�pendance de l'Alg�rie devient alors synonyme
d'abaissement de la nation.
L'installation
dans une situation d'amn�sie, � propos de l'Alg�rie, conduit � une
interrogation sur l'oubli. Apr�s la terrible p�riode de la guerre, comment
est-il possible de vivre perp�tuellement en �tat de m�moire fr�n�tique, m�lancolique,
envahissante ? Il faut peut-�tre aussi, quelquefois oublier pour vivre. Et puis
existe un autre oubli, organis� par les Etats, qui instaure des amnisties,
visant � dissimuler, � ne pas assumer ses torts ou ses responsabilit�s. C'est
un autre type d'oubli. Derri�re l'oubli n�cessaire, celui de la sortie d'une
guerre, se dissimule l'oubli pervers visant � ne rien reconna�tre de la
culpabilit� qui s'est longtemps cach�e dans la soci�t� fran�aise.
Sur
les circonstances du retour de la guerre d'Alg�rie dans la soci�t� fran�aise
d'aujourd'hui, un �l�ment domine, le passage des g�n�rations. Celui qui a v�cu
un �v�nement d�cisif �prouve le d�sir de laisser une trace. Au soir d'une
vie appara�t la n�cessit� de se d�livrer davantage d'un poids, d'un secret
ou d'un remords. De leur c�t�, les jeunes g�n�rations �prouvent le besoin
de s'inscrire dans une g�n�alogie, dans une filiation, de savoir quelle a �t�
l'attitude du p�re ou du grand-p�re dans cette guerre. Cette situation-l�
s'observe dans la jeunesse fran�aise, mais aussi dans la jeunesse d'origine alg�rienne.
Dans
les g�n�rations politiques, le vote � l'Assembl�e nationale du 10 juin 1999,
� la quasi-unanimit�, reconnaissant "une guerre" en Alg�rie est r�v�lateur.
Une majorit� des d�put�s �taient des "anciens" d'Alg�rie, des
gens qui avaient connu, ou fait, la guerre d'Alg�rie. Le vote � l'Assembl�e
nationale et la pr�sence de personnages politiques au sommet de l'Etat
expliquent la volont� d'inscrire en des lieux de comm�moration la m�moire de
cette guerre. Comme la construction d'un "Mur" � Paris � la m�moire
de soldats tomb�s en Alg�rie, ou la pose d'une plaque � la m�moire des
victimes alg�riennes du 17 octobre 1961. Bref, des cadres politiques de la m�moire
se mettent en place permettant � celle-ci de s'exprimer davantage.
Un
autre �l�ment permet de comprendre ce retour : le d�tour par ce qui se passe
aujourd'hui en Alg�rie. Les enjeux br�lants de la guerre d'Alg�rie en France
s'inscrivent dans une m�moire en miroir. De l'autre c�t� de la M�diterran�e,
depuis dix ans, une guerre civile cruelle a fait des dizaines de milliers de
morts. Dans cette trag�die alg�rienne reviennent les souvenirs de la premi�re
guerre d'ind�pendance. Des mots surgissent comme "terrorisme",
"fanatisme", "massacre", "violence",
"bataille d'Alger". In�vitablement, le souvenir de la guerre pr�c�dente
vient perturber celle du pr�sent.
A travers la trag�die v�cue, des figures qui avaient �t� �cart�es de la sc�ne politique pendant la guerre d'ind�pendance, ou au lendemain de cette guerre, font retour. L'a�roport de Tlemcen s'appelle d�sormais "a�roport Messali-Hadj" et l'universit� de S�tif a pris le nom d'"un |