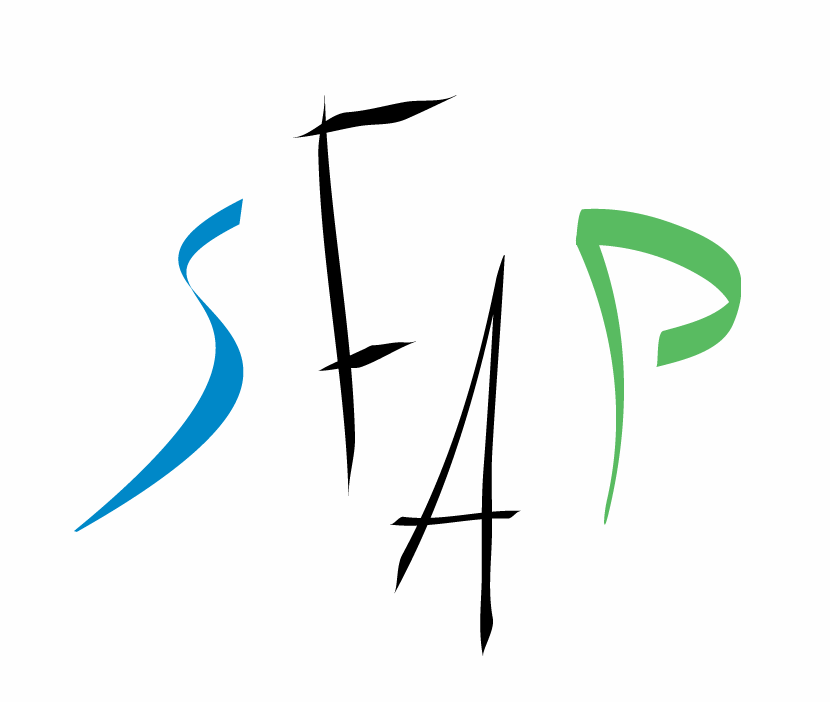
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE
|
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE |
|
On sait le rapport complexe qui existe entre ces deux cat�gories. L��tude de la m�moire a longtemps constitu� l�apanage des philosophes : de " la r�miniscence " chez Platon aux deux m�moires ch�res � Bergson (" la motrice " et " la pure " ou affective). Au XX�me si�cle, la psychologie exp�rimentale puis la biologie mol�culaire allaient s�int�resser � la question. La litt�rature en faisait cependant d�j� cas depuis quelques temps (les romantiques, Proust, et aussi Joyce, et plus tard Kateb Yacine...), et l�historiographie � travers certaines de ses manifestations (les chroniques et " les m�moires "), ainsi que l�ethnographie � travers son investigation de la tradition orale, ont assez t�t c�toy� le ph�nom�ne, sans cependant trop s��loigner du genre litt�raire. Avec leur affirmation au cours du XX�me si�cle, les disciplines sociales n�allaient pas tarder � s�en saisir comme objet d��tude. La psychanalyse tout d�abord avec son rapport du " conscient " � " l�inconscient ", et ensuite la sociologie, avec Maurice HALBWACHS, lui-m�me lecteur de DURKHEIM et de WEBER, et qui avec les cadres sociaux de la m�moire, nous produit en 1925 ce qui demeure un classique pour l�approche de la question. L�anthropologie et l�histoire n�allaient pas rester � l��cart du mouvement : la premi�re avec l�int�r�t port� au mythe, et � ce qui f�t longtemps appel� " les soci�t�s sans histoire ", la seconde avec le travaux portant sur " la longue dur�e " (BRAUDEL), et le passage " de la cave au grenier " pour reprendre le titre d�un ouvrage de Michel VOVELLE. En effet, si l�histoire a longtemps eu tendance � �tre "historisante", c�est � dire s�int�ressant en premier lieu aux faits politiques et aux " grands hommes ", elle va avec LABROUSSE et les fondateurs de l�Ecole des Annales (Marc BLOCH, Lucien FEBVRE) s�impliquer dans l��tude des faits sociaux et �conomiques ("la cave") pour �merger en "Nouvelle histoire" dont l�un des objets pris�s sera l��tude des mentalit�s ("le grenier"). En fait comme devait le constater Jack GOODY, allait tendre � s�estomper " le grand partage des savoirs " entre une anthropologie s�occupant des soci�t�s sans �criture, et une histoire n�cessitant la pr�sence de l��crit, ou encore entre une discipline s�int�ressant aux structures " inconscientes ", et l�autre aux " expressions conscientes " de la vie sociale. Anthropologie et histoire devraient tendre � se rencontrer au sein de l�anthropologie historique, et l�un des points de jonction privil�gi�s, porterait justement sur l�approche mettant en valeur des cat�gories, telles celles de longue dur�e, de mentalit� de mythe et de m�moire. On admet commun�ment que si " m�moire " et " histoire ", ont toutes deux rapport au pass�, elles sont loin pour autant de recouvrer les m�mes r�alit�s. C�est Maurice HALBWACHS qui notait que " toute m�moire collective a pour support, un groupe limit� dans l�espace et dans le temps... Le groupe au moment o� il envisage son pass�, sent bien qu�il est rest� lui-m�me, et prend conscience de son identit� � travers le temps ". Par ailleurs, " l�histoire est le recueil des faits qui ont occup� la plus grande place dans la m�moire des hommes. Mais lus dans les livres, enseign�es et appris dans les �coles, les �v�nements pass�s sont choisis, rapport�s et class�s suivant des n�cessit�s ou des r�gles qui ne s�imposaient pas aux cercles d�hommes qui ont gard� le d�p�t vivant. C�est qu�en g�n�ral l�histoire ne commence qu�au moment o� finit la tradition, moment ou se d�compose ou s��teint la m�moire sociale ". Le probl�me est qu�avec les bouleversements que traverse le monde contemporain : restructuration internationale, crises, prolif�ration de l��dition et de l�audiovisuel, �mergence ces derni�res d�cennies de dizaines de nouveaux Etats, dont beaucoup en sont d�j� au stade du " d�senchantement national ", replis identitaires, et volont� de nombreuses cat�gories sociales de ne pas �tre r�duites au statut de " laiss�s pour compte " de l�histoire, on assiste � un foisonnement d��crits, de films et autres manifestations, comm�morations et documents, qui rel�vent de ce qui est devenu l�ethnohistoire, ou encore le " devoir " de m�moire. Dans une large mesure, les histoires nationales ont fonctionn� � l�institutionnel, servant � l�gitimer les positions sociales des groupes dominants, et l�histoire universelle a longtemps �t� marqu�e par la pr��minence de l�Europe et son empreinte occidento-centriste, ceci et cela ne pouvant pas ne pas entra�ner les effets de retour que l�on conna�t en cette fin du second mill�naire. Avec les pr�occupations mises en avant par ce qu�on appellera au sens large, la nouvelle histoire et l�anthropologie historique, les chercheurs semblent vouloir tirer profit de cette demande de m�moire, quittes � produire un regard critique sur leur propre pratique, et � aff�ter leur m�thodologie d�approche, en tenant compte du fait que : " Parce qu�elle est affective et magique, la m�moire ne s�accommode que de d�tails qui la confortent. Elle se nourrit de souvenirs flous, t�lescopants, globaux ou flottants, particuliers ou symboliques, sensibles � tous les transferts, �crans, censure ou projection. L�histoire parce que op�ration intellectuelle et la�cisante, appelle analyse et discours critique. La m�moire installe le souvenir dans le sacr�, l�histoire l�en d�busque, elle prosa�se toujours ". Dans ce num�ro de INSANIYAT, nous vous proposons sept articles th�matiques (�crits en arabe ou en fran�ais), portant justement sur le traitement de la m�moire par l�historien qui � l�occasion devra se faire anthropologue ou m�me sociologue. Ces contributions dont on trouvera par ailleurs les r�sum�s en plusieurs langues, portent toutes sur l�Alg�rie o� la question de " l��criture " ou " r��criture de l�histoire " continue d��tre pos�e . Deux d�entre elles traiteront de l�intervention institutionnelle dans cette �criture de l�histoire, l�une � travers la pratique de l�historiographie coloniale (par Fouad SOUFI), l�autre � travers la repr�sentation de l�histoire nationale, telle qu�elle est enseign�e depuis l�ind�pendance du pays (par Hassan REMAOUN). Deux autres articles nous replongeront dans l�atmosph�re de la p�riode coloniale et de la guerre de lib�ration en scrutant la m�moire des femmes moudjahidate (par Malika EL KORSO), ou encore celle d�une ville, Sidi-Bel-Abb�s (par R�douane A�NAD-TABET). A partir d�un document d�archive, on t�chera de m�me de faire connaissance avec un notable lettr� makhz�nien ayant v�cu � Oran dans la premi�re moiti� du XIX�me si�cle (par Sadek BENKADA). Nous remonterons ensuite jusqu�au XVIII�me si�cle pour aborder la repr�sentation des tremblements de terre et le ph�nom�ne de la peur, dans l�historiographie traditionnelle alg�rienne (par Mohamed GHALEM), et confronter les cheminements de la m�moire et de l�histoire � Constantine � propos de la personnalit� de Salah Bey (par Ounassa SIARI TENGOUR). La partie th�matique de cette livraison sera par ailleurs compl�t�e par des notes de lecture, et une pr�sentation des travaux produits dans le cadre du CRASC, ainsi que d�une s�lection bibliographique portant sur des ouvrages disponibles (ou en voie d�acquisition) � la biblioth�que du centre de recherche. En se reportant au sommaire de la revue, on pourra par ailleurs se r�f�rer aux textes de A�cha GHETTAS ( � partir de documents alg�rois datant de l��poque Ottomane), Kamel FILALI (position de recherche autour de la question du mysticisme et du maraboutisme au Maghreb) et Am�ziane FERGUENE (abordant la question de l�identit� et de l'Etat nation), ainsi qu�� d�autres rubriques habituelles. Hassan REMAOUN (CRASC)
|