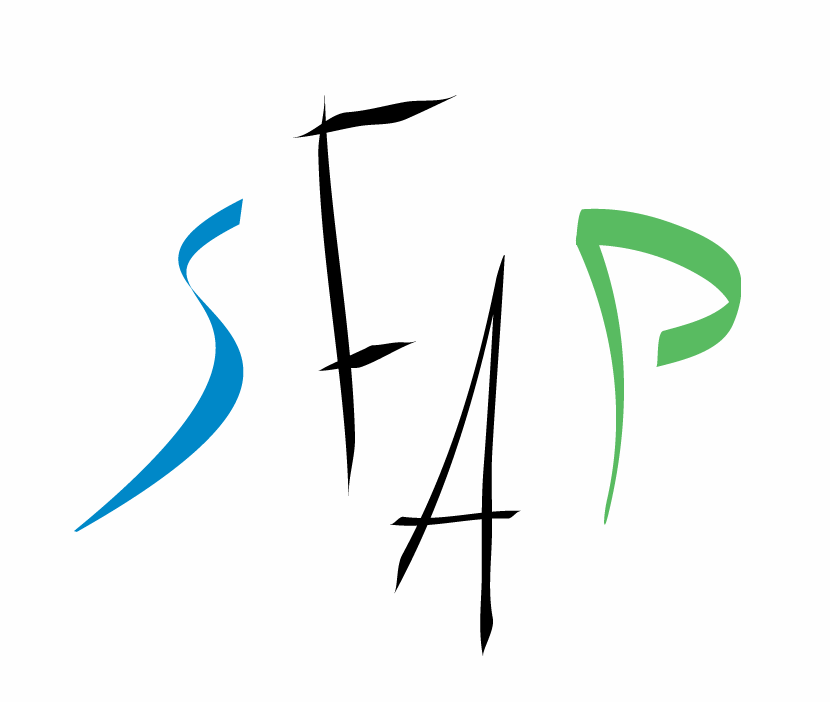
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE
|
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE |
|
� �
� VENDREDI 3 octobre 2003 08h00-09h00���� Accueil 09h00-09h05���� Allocution de bienvenue : Mr Louis Omnes, Directeur G�n�ral de l'HEGP 09h05-09h15���� Introduction du Pr�sident du congr�s�: Professeur Fr�d�ric Rouillon 09h15-9h30���� Allocution de Monsieur Mohammed Bedjaoui (Pr�sident du Conseil Constitutionnel, ancien Pr�sident de la Cour Internationale de Justice) 09h30-10h00���� Communication: Monsieur Benjamin Stora, Professeur d'histoire du Maghreb � l'INALCO� ��� Titre: "France - Alg�rie : de la m�moire � l'histoire "10h00-10h30���� Communication: Professeur Louis Crocq, psychiatre ��� Titre�: "Fausse m�moire et syndrome de r�p�tition" 10h30-10h45���� Discussion coordonn�e par Pr F. Rouillon 10h45-11h00 Pause 11h00-11h30���� Communication: Mme Ma�ssa Bey, Ecrivain ��� Titre: "Les cicatrices de l�histoire" 11h30-12h00���� Communication: Mme Marie-Odile Godard, Ma�tre de Conf�rence, Universit� de Picardie ��� Titre�: "M�moire d�Alg�rie, r�ves et fond d�horreur" 12h00-12h30���� Discussion, coordonn�e par Pr H. L�o 12h30-13h30���� D�jeuner 13h30-15h00���� Symposia Premier symposium organis� par Alice Cherki: "Les enjeux psychiques des silences de l'histoire", avec Alice Cherki, Olivier Douville (Psychanalyste, Ma�tre de conf�rence, Directeur de publication de la revue Psychologie Clinique Deuxi�me symposium organis� par Dr Louis Jehel , Coordonnateur, ( Unit� de Psychiatrie et Psychotraumatisme) et Dr Christian Navarre, Mod�rateur (Psychiatre, Centre Hospitalier du Rouvray � Rouen ): "Psychotraumatisme et actes de terrorisme". 1/ Facteurs pr�dictifs de stress post-traumatique aupr�s de victimes de terrorisme (L. Jehel), 2/ La dissociation p�ritraumatique comme ultime recours face au terrorisme (Clara Duchet, psychologue), 3/ Approche cognitivo-comportementale d'un cas de psychotraumatisme chez une victime d'acte terroriste (Nathalie Camart, psychologue) Troisi�me symposium organis� par Dr Patrice Louville (Consultation de Psychotraumatisme-Maltraitance, H�pital Corentin Celton) et Dr St�phane Mouchabac (h�pital Saint Antoine) "Psychotraumatisme, m�moire et cognitions" 15h00-15h15���� Pause 15h15-15h45���� Communication: Professeur Mohamed Boudef (Chef de service, Annaba) ��� Titre :"Mod�lisation de l'�tat de stress post-traumatique" 15h45-16h15���� Communication: Professeur Patrice Boyer, CNRS UMR 7593 (H�pital Salpetri�re) ��� Titre�:� ��Traumatisme psychique et troubles de la m�moire: une approche neurobiologique�� 16h15-16h30���� Discussion, coordonn�e par Pr J.M. Azorin (Marseille) 16h30-16h45���� Pause 16h45-17h15���� Communication: Professeur Nadir Marouf, Docteur en Lettres, Docteur en Droit, Professeur en Anthropologie, Directeur du CEFRESS ��� Titre�: " M�moire des traumatisme, traumatisme des m�moires: � propos de violences durant la guerre d'ind�pendance, choses vues, choses entendues, choses subies." 17h15-17h05���� Communication: Dr Mohamed Chakali, Psychiatre (Alger) ��� Titre�: ��Frantz Fanon et le psychotraumatisme�� 17h05-17h15���� Discussion coordonn�e par le Pr M. Tedjiza (Alger) � Fin de la premi�re journ�e
SAMEDI 4 octobre 2003 08h30-09h30���� Accueil 09h30-10h00���� Communication: Dr Serge Bornstein, Neuro-Psychiatre, Expert agr�� pr�s le Bureau de la Cour de Cassation, Charg� de cour � la Facult� de M�decine Paris-Sud ��� Titre : "Approche expertale du psychotraumatisme de guerre.�� 10h00-10h30���� Communication: Docteur Tahar Absi, Professeur de psychologie et des Sciences de l�Education. Universit� d�Alger. Pr�sident du colloque sur la pr�sence des religions monoth�istes en Alg�rie (UNESCO, janvier 2003) ��� Titre: "Impact de la m�moire traumatique individuelle et collective sur l��criture de l�histoire." 10h30-10h45���� Discussion, coordonn�e par Pr S. Consoli (Paris) 10h45-11h00���� Pause 11h00-11h30���� Communication: Zahia Rahmani, �crivain, enseigne l'histoire de l'art ��� Titre: " L'�criture du d�terrement" 11h30-12h00���� Communication: Eric Savar�se, Docteur en Science Politique, Ma�tre de Conf�rence � l'universit� de Perpignan ��� Titre : "Entre guerre des m�moires et m�moire des guerres. A propos des militants associatifs Pieds-Noirs" 12h00-12h15���� Discussion, coordonn�e par Omar Calier, Professeur d'histoire � l'Universit� Paris I 12h15-13h30���� D�jeuner 13h30-15h00���� Symposia Quati�me symposium organis� par le Pr Mohammed. Boudef, "Violence, toxicomanie et comportement suicidaire" avec les Dr Labidi, Zeghib (Annaba), Ph. Carette (Paris) et B. Riff (Lille) Cinqui�me symposium organis� par le Pr Farid Kacha "Les psycho-traumatismes". 1/ Quand les �motions manquent d'air "e" (Dr D. Benmessaoud, Alger), 2/ Famille, guerre et g�n�ration (Dr A. A�t Ameur, Alger), 3/Rescap� de l'enfer (Dr K. Ammar, Alger), 4/ Organiser la prise en charge (Dr M. Chakali, Blida), 5/ Stress en milieu sub saharien (dr F. Bouch�ne, Laghouat). Sixi�me symposium organis� par le Pr Marie-Rose Moro " La psychiatrie coloniale en Alg�rie��, coordonnateur�: Dr T. Ferradji. 1/ De la psychiatrie coloniale � la psychiatrie transculturelle (Pr M. R. Moro), 2/ L�homme maghr�bin dans les �crits psychiatriques (Dr Berthelier), 3/ La repr�sentation de la femme alg�rienne dans la psychiatrie coloniale (Dr K. Marrois), 4/ L�Ecole d�Alger ou la transmission forclose (Dr T. Ferradji), 5/ La psychiatrie coloniale (Dr H. Herbane, Djelfa) 15h00-15h15���� Pause 15h15-15h45���� Communication: Claire Mauss-Copeaux, agr�g�e d'Histoire, Chercheur au CNRS et au GREMMO ��� Titre�: ��Souffrance, m�moires et histoire d'Alg�rie�� 15h45-16h05���� Communication: Professeur Abderahmane Bela�d, Dr Nac�ra Moussi, Dr Ferrou Da�dj, Pr Farid Kacha, h�pital M. Boucebci, (Alger) ��� Titre: "M�moire et souffrance" 16h05-16h20���� Discussion, coordonn�e par Pr F. Kacha (Alger) 16h20-16h35���� Pause 16h35-16h55���� Communication: Sylvaine Artero, Isabelle Beluche, Jean-Phillipe Boulenger, Karen Ritchie INSERM : E 0361 (Montpellier)��� Titre : Pr�valence des troubles psychiatriques dans une population �g�e expos�es aux psycho-traumatismes de la guerre d�Alg�rie�: l��tude ESPRIT� 16h55-17h25���� Communication�: Pr Slimane Medhar, Professeur � l�Universit� d�Alger ��� Titre�: ��Le traumatisme culturel de la colonisation�� 17h25-17h45���� Communication�: Docteur Hakima Souki, Ma�tre-assistante en psychiatrie (Alger) ��� Titre�: ��Les aspects culturels dans l�expression du psychotraumatisme�� 17h45-18h00���� Discussion g�n�rale et conclusions du congr�s coordonn�e par le Pr F. Rouillon Fin du congr�s
Auteurs et interventions � Benjamin Stora (Professeur d'histoire du Maghreb � l'INALCO) France-Alg�rie : De la m�moire � l'histoire. Le difficile consensus des m�moires autour de la guerre d'ind�pendance alg�rienne, Beaucoup de choses ont �t� dites et �crites en Alg�rie et en France, entre 1999 et 2002, sur la question des enjeux de m�moire autour de la guerre d'Alg�rie. Parmi cette v�ritable explosion m�morielle, marqu� par une s�rie de publications d'articles de presse et de livres de t�moignages, il y eut le vote � l'Assembl�e Nationale fran�aise, d'une proposition de loi visant � la reconnaissance du terme de " guerre " pour qualifier les �v�nements advenus en Alg�rie entre 1954 et 1962. De nombreuses pol�miques lui ont fait suite, dont le point culminant fut sans doute la parution du livre du g�n�ral Aussaresses, qui a d�clar� avoir assassin� des leaders du nationalisme alg�rien. En Alg�rie, une violente pol�mique a �clat� � l'�t� 2002 � propos des conditions de l'assassinat en 1957 d'Abane Ramdane, un important dirigeant du FLN tu� par ses compagnons d'armes. Dans la seule ann�e 2001, de nouveaux lieux de m�moire en France attach�s � la guerre d'Alg�rie sont apparus : la plaque appos�e sur le pont Saint-Michel � la m�moire des victimes alg�riennes de la manifestation du 17 octobre 1961, une st�le a �t� inaugur� en plein centre de Paris par Jacques Chirac, le pr�sident de la R�publique, � la m�moire des 25 000 soldats fran�ais morts en Alg�rie. En Alg�rie, le pr�sident Abdelaziz Bouteflika a d�cid� de donner des noms de dirigeant, longtemps mis au secret de l'histoire officielle, � des a�roports alg�riens (Messali Hadj, Mohamed Khider, Mohamed Boudiaf). Il n'est plus possible d'aborder aujourd'hui la question des enjeux de m�moire en termes d'occultation comme je l'avais fait en 1991 dans mon ouvrage La gangr�ne et l'oubli . Quelles sont les nouvelles probl�matiques concernant le rapport de la m�moire � l'histoire ? Quelles sont les nouvelles formes de mise en m�moire, et d'�criture de l'histoire autour de la guerre d'ind�pendance en Alg�rie, en France ? Et pourquoi est-il si difficile de construire un consensus m�moriel autour de cette s�quence br�lante entre les deux pays, la France et l'Alg�rie?
Claire Mauss-Copeaux, agr�g�e d'histoire, est chercheur au CNRS � Lyon et au GREMMO (Groupe de Recherches et d'Etudes sur la M�diterran�e et le Moyen-Orient). Souffrance, m�moires et histoire d'Alg�rie. Les r�cits les plus anciens de l'histoire de l'humanit� font de la guerre l'�v�nement par excellence et d�crivent longuement la souffrance de quelques h�ros exemplaires choisis parmi les combattants. En Occident, en France aussi, l'histoire-bataille, les "grands" �v�nements, b�n�ficient de la faveur des historiens mais leur approche n'est pas un sujet � part enti�re. Dans un premier temps je m'attacherai � pr�ciser les obstacles culturels, sociaux et politiques qui se sont oppos�s et s'opposent encore � l'�vocation et � la prise en compte de la souffrance des combattants. J'�valuerai ensuite les informations que les v�t�rans donnent sur la violence de la guerre, sur les sentiments qu'ils ont �prouv�s ou �prouvent encore aujourd'hui. L'analyse des diff�rentes situations d'�nonciation, du discours lui-m�me avec ses oublis et ses occultations me permettra de compl�ter et d'affiner, pour reprendre l'expression de G. Dum�zil, ces "Heurs et malheurs du guerrier". Pour conclure, je m'interrogerai sur les implications de ce travail de deuil partag� o� interviennent � la fois la m�moire et l'histoire ainsi que sur les enjeux de la reconnaissance (instrumentalisation de la souffrance et victimisation des combattants)
Sylvaine Artero, Isabelle Beluche, Jean-Phillipe Boulenger, Karen Ritchie (INSERM, Montpellier) Pr�valence des troubles psychiatriques dans une population �g�e expos�e aux psycho-traumatismes de la guerre d�Alg�rie : l'Etude ESPRIT L��tude ESPRIT (Etude �pid�miologique de l�Etat de sant� mentale des personnes �g�es en France ) est la plus grande �tude des troubles mentaux r�alis�es dans une population fran�aise qui permet d��tablir une base de donn�e unique en �pid�miologie psychiatrique. Cette �tude r�alis�e depuis 1999 � partir de 1863 personnes �g�es de 65 ans et plus repr�sentatives du district de Montpellier est compos�e d�environ un tiers de personnes rapatri�es d�Alg�rie ou ayant directement particip� � cette guerre. Cette �tude repr�sente donc une opportunit� unique d��valuer les troubles mentaux dans une population expos�e aux psycho-traumatismes de la guerre d�Alg�rie et de comparer ces pr�valences � une population �g�e t�moin.M�thode : La passation d�un questionnaire psychiatrique : le MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview (version francaise 5.00)) a �t� effectu� sur notre population. Il s�agit d�un entretien diagnostic structur� construit sur un syst�me algorithmique qui explore les principaux troubles psychiatriques de l�axe I du DSM-IV et permet d��valuer la pr�sence de troubles psychiatriques actuels et sur la vie enti�re. En parall�le d�autres donn�es concernant les �v�nement de vie ainsi que des donn�es cliniques ont �t� collect�s. Tous les participants ont �galement pass� un examen neurologique.
Marie-Odile Godard, Ma�tre de Conf�rences � l�Universit� de Picardie - Jules Verne M�moire d�Alg�rie, R�ves et Fond d�horreur. Appel�es pour leur service militaire, de jeunes recrues �trang�res � l�arm�e furent envoy�es dans une contr�e m�connue: l�Alg�rie. Ils avaient tous �t� reconnus aptes � supporter la guerre lors d�une visite d�incorporation. Cependant, tous ceux que j�ai rencontr�s en sont rest�s marqu�s, traumatis�s. Depuis leur retour, ils ont toujours souffert, mais ils ne savent pas qu�ils souffraient de l� bas. Le jour, ils arrivent � oublier, mais la nuit, dans les r�ves traumatiques, tout revient. Compar�e au moment du traumatisme, la situation du r�ve a ceci de diff�rent que le traumatis�, lors de cet �v�nement, n�est pas seul. Mais lors des cauchemars et des r�ves traumatiques, apr�s la reproduction de l�image, de l�action, il est seul et se sent seul responsable. Introduire un tiers dans cette configuration peut l�emp�cher de tomber dans la folie. Nous �tudierons comment, nuit apr�s nuit, s�est constitu� pour chacun d�eux un fond d�horreur partag� auquel il font continuellement r�f�rence. Ce fond d�horreur constitu� de mots, d�images, de cris, d�odeurs, leur sert � exprimer tout ce qu�ils ont � dire, tout ce qu�ils ressentent. Leur vie psychique se r�organise autour de lui.
Ma�ssa Bey, �crivain Les cicatrices de l'histoire Mon intervention portera sur la difficult� de mettre en mots une sc�ne que l'on n'a pas v�cue mais qui est fondamentale dans la m�moire et l'imaginaire. Ci-joint un passage de ce texte : "J'ai longtemps, tr�s longtemps h�sit� avant d'�crire, non pas sur la guerre, mais sur ce qui m'appara�t � moi comme un questionnement fondamental : le bouleversement profond, total, irr�m�diable et irr�missible que repr�sente une guerre dans la vie de ceux qui la font, qui la subissent (directement ou indirectement) et qui en portent � jamais les s�quelles, s�quelles qui ne s'effacent pas avec un cessez-le-feu ou des trait�s ou des accords de paix. J'ai longtemps h�sit� parce que je ne voulais pas, qu'� l'instar de beaucoup d'�crivains de mon pays ou d'ailleurs, mon travail d'�criture soit centr� sur la d�ploration et/ou la c�l�bration d'un pass� forc�ment glorieux �lev� au rang de mythe qui d�termine tout le devenir des g�n�rations suivantes. Et c'est peut-�tre plus cela qui m'a pouss�e � revenir sur une part de mon histoire que le d�sir de ne plus diff�rer le moment de la confrontation. Il y a aussi bien entendu un cheminement individuel, une qu�te qui ne peut aboutir que si l'on prend le temps de rassembler tous les fragments qui constituent notre propre histoire. Besoin de comm�moration � au sens de "se souvenir ensemble", d'associer le lecteur au souvenir � besoin d'�lucidation, d'�vocation d'une histoire qui ne serait pas falsifi�e ou d�form�e par la m�moire, par la m�moire des autres, par la mienne aussi. Parce que lorsqu'on veut convoquer les souvenirs, surtout lorsqu'il s'agit de souvenirs d'enfance, on s'aper�oit souvent qu'on a tendance � confondre ce que d'autres nous ont racont� avec ce que nous avons vraiment v�cu. La pr�gnance des images surajout�es fait souvent obstacle � la restitution. Et c'est alors qu'intervient l'imaginaire. Approcher le plus possible, par la re-cr�ation, d'instants que l'on n'a pas v�cus. Mais qui ont forg� tout notre �tre, toute notre conscience du monde. Des images fantasm�es d'une sc�ne "engramm�e" que je n'h�site pas � qualifier de sc�ne primitive. C'est cela que j'ai tent� de faire dans mon dernier livre: "Entendez vous dans les montagnes". Une sorte de reconstitution au sens policier du terme. " Auteur de : "Entendez-vous dans les montagnes..." Editions de l'Aube, �ditions Barzakh, 2002
Zahia Rahmani, �crivain, enseigne l'histoire d l'art MOZE ou l'�criture du d�terrement :commentaires sur la construction d'un r�cit litt�raire. "Faut-il rendre justice � Moze ? Que peut-on lui rendre ? Que lui a-t-on pris ? Sa vie, sa libert�, ses biens, son honneur ? Peut-on les lui rendre? Que lui a-t-on fait? On l'a d�sarm�, abandonn�? On lui a menti? On l'a utilis�, exploit�, m�pris� ? On ne peut lui rendre. et que peut-on me rendre? Il va falloir trouver. Me donner ce qu'on ne peut me rendre. Moze �tait mon p�re, un p�re que je n'ai pas eu. un p�re qui ne l'�tait pas. Maintenant qu'il est mort, serait-il devenu martyr? Moze avait honte de ce pays. encore plus que pour lui". MOZE est un livre consacr� � une figure militaire contemporaine issue des guerres d'�mancipations des peuples colonis�s : le suppl�tif. Le contexte est celui de la guerre d'Alg�rie, Moze a �t� un � acteur � de cette guerre, puisqu'il a �t� recens� comme soldat fran�ais musulman de l'arm�e d'occupation, un harki. A partir d'un fait r�el : le suicide en France, le 11 novembre 1991 de cet homme, - Moze s'est rendu devant le monument aux morts. Il a salu� les hommes qui �taient l�. Ensuite il s'est noy�. Moze �tait mon p�re - j'ai tent� par l'�criture d'un r�cit de rendre compte de la signification historique, politique et " esth�tique " de son geste. L'av�nement de ce texte rel�ve d'une exp�rience litt�raire enserr�e dans une pratique analytique. C'est par cette double exp�rience que l'�criture de MOZE est parvenue. C'est de ces deux exp�riences qui sont " parties prenantes " et que je ne peux d�faire l'une de l'autre, dont je t�moigne. Il sera donc ici question de la disposition analytique, - du travail "de d�terrement " - parall�le � l'�criture de Moze. J'entends par d�terrement tout le travail pr�alable � la construction de ce r�cit litt�raire. Tout t�moignage n�cessite une double �criture. Ce qui a �t� d�terr� doit �tre consign�. Le d�terrement, sa trace, peut-�tre multiple : r�ve, propos recueillis, archives, id�es survenues, notes sur l'�tat de soi ou la pratique de l'�criture automatique... Ces formes, peuvent �tre gliss�es dans le texte en leur �tat premier ou pris dans une autre expression, plus distanc�e et plus constitutive de sens : la litt�rature. Le d�terrement dont je parle ne renvoie pas � l'acte physique qui consisterais � soulever avec une pelle un morceau de terre que l'on d�pose � proximit� tout en laissant appara�tre un trou. Mais cette acte peut servir de m�taphore : le geste qui soul�ve serait l'ensemble anim�, agit� m�me par la pratique analytique et la terre soulev�e et qui est en reste, est le fonds, la mati�re qui sert � combler le trou qui est la vacance de l'�tre mort et disparu sur lequel on - parle - �crit. Auteur de "Moze", Sabine Wespieser Editeur. Mars 2003: Si la litt�rature ne fera pas le compte de la guerre d'Alg�rie, ce livre dit pourtant la fabrique de cet homme-l� : le colonialisme et ses exc�s, l'ignorance et le m�pris, l'absurdit� tragique d'une situation et en toute fin la b�tise des hommes. Par-del� le t�moignage, par-del� l'�vocation d'une famille marqu�e par une existence solitaire, l'�criture de Zahia Rahmani, magistralement tendue, concise et pudique, convoque une d�chirure, un doute, une plainte, d'une v�rit� bouleversante. Moze nous parle de tous les laiss�s-pour-compte de l'histoire et de la douloureuse difficult� d'en assumer la filiation. De l'impossibilit� d'�chapper � ses p�res. �
Eric Savarese , Ma�tre de Conf�rence en Science Politique � l'Universit� de Perpignan. Ses travaux portent sur les questions relatives � la l�gitimation de la colonisation, � la nationalit�, � l'immigration. L'invention des Pieds - Noirs (Paris, S�guier, 2002) est son dernier ouvrage Entre guerres de m�moires et m�moires de guerre. A propos des militants associatifs Pieds � Noirs. Le terme de Pieds - Noirs ne d�signe les anciens Fran�ais d'Alg�rie qu'� partir de 1954, soit au moment du d�clenchement de la guerre d'ind�pendance, lorsque les anciens "Fran�ais Musulmans" se proclament "Alg�riens". C'est donc essentiellement dans l'ancienne m�tropole que le terme de Pieds - Noirs a pu �tre utilis� pour d�signer pr�s d'un million d'individus ayant quitt� l'Alg�rie au moment de son ind�pendance. Au moment o� ils quittent l'Alg�rie, les Pieds - Noirs ne constituent pas, � proprement parler, un groupe homog�ne, et l'examen de l'�norme litt�rature publi�e dans l'exil montre � quel point les clivages, notamment en mati�re de perception de l'histoire coloniale et de la guerre d'Alg�rie, sont nombreux. D'o� l'enjeu, pour les militants associatifs, de valoriser une m�moire dont la promotion participe � l'�laboration d'une v�ritable strat�gie identitaire : c'est pour construire un groupe influent que les militants contribuent � le produire en participant aux guerres de m�moires alg�riennes qui les opposent, parmi d'autres, aux "anciens combattants", aux "porteurs de valises", aux "immigr�s", etc... Cet investissement dans des guerres de m�moires doit �galement �tre associ� � l'analyse de m�moires de guerre qui parfois agissent, aujourd'hui encore, sur les perceptions du ph�nom�ne de l'immigration. En revivant le souvenir d'un conflit ou l'ennemi n'est pas clairement distingu� des Fran�ais Musulmans qui partagent le quotidien des Fran�ais d'Alg�rie, des Pieds - Noirs semblent projeter sur la situation actuelle des peurs n�es pendant la guerre d'Alg�rie. L' impossible diff�renciation entre l'image du "fellaga" et celle, fortement ambivalente, de "l'Arabe", nourrit aujourd'hui encore la construction d'un discours sur l'Autre qui renvoie aux traumatismes li�es � la guerre d'Alg�rie.
Nadir Marouf : Docteur en Lettres, Docteur en Droit. Professeur en anthropologie � l'Universit� de Picardie. Directeur du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Sciences Sociales (CEFRESS) Nadir Marouf a rejoint le maquis durant la guerre d'Alg�rie alors qu'il n'�tait qu'un jeune adolescent. Il a ainsi connu la prison et la torture. Il retracera le v�cu de l'adolescent plong� brutalement dans les horreurs de la guerre et t�moignera de toute l'acuit� de la m�moire traumatique et des souvenirs r�guli�rement revisit�s dans l'intimit� de la solitude. M�moire des traumatismes, traumatisme des m�moires : � propos de violences durant la guerre d'ind�pendance, choses vues, choses entendues, choses subies. Le souvenir de la guerre s'op�re par sensualisme �pisodique, latent ou discontinu, r�manent ou provoqu� par une rencontre inopin�e avec un ami de jadis ou un film sur l'Alg�rie. Les tentatives, tout � fait r�centes d'exorciser par l'�criture ce souvenir de l'adolescence, calent devant une ambivalence implacable entre une posture de "divan" (jamais r�alis�e) et une posture de distanciation critique (avort�e � peine commenc�e).
Docteur Tahar Absi, Professeur de psychologie et des Sciences de l�Education (universit� d'Alger). Pr�sident du colloque sur la pr�sence des religions monoth�istes en Alg�rie � travers les �ges. (Janvier 2003, UNESCO, Paris) "Impact de la m�moire traumatique individuelle et collective sur l��criture de l�histoire." L��criture de l�histoire d�un pays � une p�riode donn�e est conditionn�e � la fois par les documents de l��poque et les t�moignages recueillis. Si la guerre d�Alg�rie est v�cue des deux c�t� de la mer M�diterran�e par les communaut�s alg�riennes et fran�aises comme un drame, la violence qui s�y rattache est souvent d�crite par les deux parties comme la cons�quence l�gitime d�une autre violence. Elle devient ainsi un moyen de masquer la r�alit� et quelquefois de la d�former. Il est important de souligner que la guerre qui engendre la violence ou la violence qui engendre la guerre, bouleversent les rapports sociaux, r�duisent le raisonnement des personnes, inhibent les valeurs morales universelles et rendent l�individu incapable de discerner le vrai du faux. Certains t�moignages qui mettent l�accent sur des �v�nements grossis � la puissance (n), dans le cadre de confessions m�diatiques euphoriques, d�notent une activit� mentale d�r�gl�e et le d�sir inconscient de para�tre sous l�habit de h�ros. Ceci donne � leurs t�moignages une port�e tr�s relative au point d��tre consid�r�s comme fantaisistes. Les mass- m�dias alg�riens des ann�es de l�ind�pendance de l�Alg�rie se sont servis de cet �tat post traumatique de notre soci�t� pour renforcer les options du pouvoir politique et influer ainsi indirectement sur l��criture de l�histoire.
Serge Bornstein : Neuro-Psychiatre, Expert inscrit sur la Liste Nationale, agr�� pr�s le Bureau de la Cour de Cassation, Responsable du Dipl�me de Psychiatrie L�gale � la Facult� de M�decine de Paris-Sud. " Approche expertale du psychotraumatisme de guerre " A la suite des travaux de C. Barrois, S.
Bornstein , B. Sigg, la n�vrose traumatique a fait son entr�e dans la grand
bar�me des pensions militaires et des victimes de la guerre d'Alg�rie. |