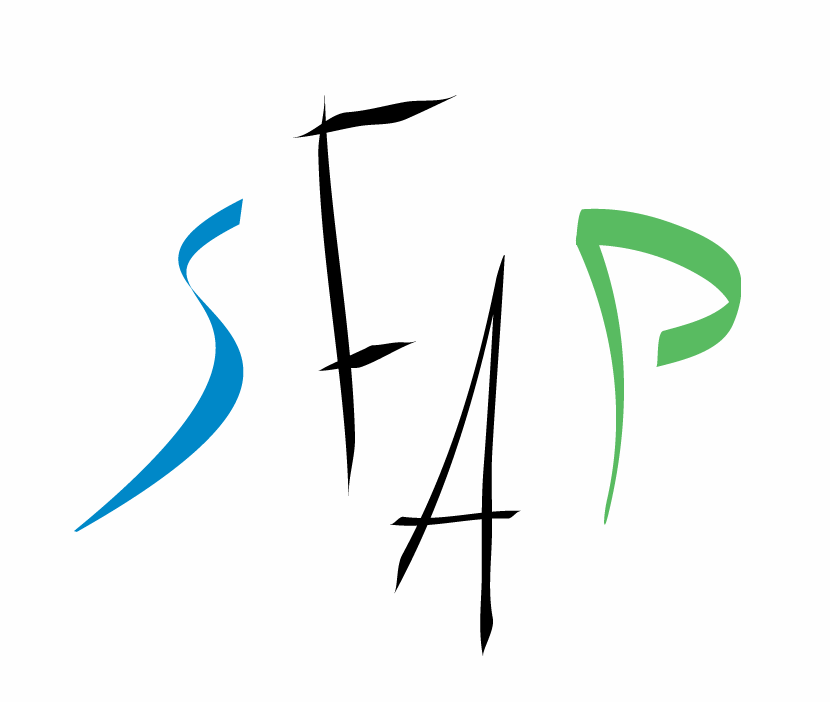
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE
|
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE |
|
� �Etude interculturelle de la Schizophr�nie. Comparaison de patients fran�ais autochtones et maghr�bins de seconde g�n�ration* M.
TALEB, F. ROUILLON, F. PETITJEAN, Ph. GORWOOD
�
* Etude parue dans Psychopathology:� "Cross-Cultural Study of
Schizophrenia" 1996; 29:85-94 INTRODUCTION Si l'�tude interculturelle des troubles psychotiques est ancienne (1), elle fut longtemps l'objet d'�laborations th�oriques au d�triment des approches �pid�miologiques interculturelles qui constituent pourtant un des abords essentiels � la compr�hension de l'influence culturelle sur le processus schizophr�nique. Elles supposent la r�alisation d'�tudes rigoureuses (2) et l'utilisation d'outils permettant une fiabilit� des comparaisons (crit�res diagnostiques, techniques de recueil des donn�es, �chelles d'�valuation psychopathologique...). De tr�s nombreuses strat�gies de recherche ont �t� utilis�es pour l'approche transculturelle des troubles mentaux. Parmi cette h�t�rog�n�it� m�thodologique, il convient de souligner que le recueil de donn�es peut se faire au niveau de centres g�ographiquement diff�rents ou � partir de populations de cultures diff�rentes vivant dans le m�me environnement social et �conomique (3). Cette derni�re situation est r�alisable du fait de l'implantation� dans certains pays de populations immigr�es d'origines ethno-culturelles diff�rentes de celle du pays d'accueil. ��������
L'implantation
en France d'une population d'origine maghr�bine est une des situations
susceptibles d'int�resser le chercheur pour des �tudes comparatives. En effet,
depuis quelques ann�es l'int�r�t des psychiatres s'est d�plac� des migrants
(4, 5, 6) vers les g�n�rations issues de la migration (7, 8, 9). Les sujets
dits "de seconde g�n�ration" donnent l'occasion d'entreprendre des
�tudes comparatives int�ressantes � plus d'un titre. Ils ont en principe acc�s
aux m�me structures de soins que les autochtones et peuvent, par exemple, �tre
�valu�s avec les m�mes instruments de mesure sans que se pose le probl�me de
la barri�re linguistique.
�����������
On entend par Maghr�bins "de seconde g�n�ration" les enfants
n�s de parents ayant migr� des pays du Maghreb vers la France et y r�sidant
encore (10). La plupart d'entre eux sont de nationalit� fran�aise. On les
appelle �galement les g�n�rations issues de l'immigration, les enfants de la
transplantation, les maghr�bins de France, les fran�ais d'origine maghr�bine,
les enfants post migrants, les enfants de la transculture et plus r�cemment les
"Beurs". Ces diff�rentes appellations traduisent une difficult�
certaine � d�finir d'une mani�re pr�cise cette population. Leurs parents
sont originaires des pays du Maghreb (Alg�rie, Maroc, Tunisie) et se sont
principalement install�s en France � la suite du flux migratoire des ann�es
soixante. La plupart de ces enfants sont n�s en France ou s'y sont install�s
tr�s jeunes. Le recensement de 1982 (8) estimait la population d'origine maghr�bine,
vivant en France, � pr�s de 1 800 000 personnes dont plus de 400 0000
adolescents.
�����������
Rappelons, enfin, que les pays du Maghreb sont relativement homog�nes
sur le plan ethno-culturel et social: on y parle les m�mes langues (arabe ou
berb�re), la religion musulmane y est pr�dominante, leur histoire et leurs
origines sont communes, les modes de vie et les structures sociales y sont
similaires... La situation en France des immigr�s originaires de ces pays est
�galement identique. Vivant pour la plupart, dans les m�mes ensembles sociaux,
occupant des situations professionnelles et �conomiques comparables, ils
subissent les m�mes difficult�s de l'existence.
�����������
De nombreux auteurs se sont r�cemment interrog�s sur l'identit� des
maghr�bins de deuxi�me g�n�ration. Si cette question fait encore l'objet de
d�bats, nous pouvons n�anmoins rep�rer trois �l�ments essentiels qui caract�risent
ces sujets :
� Ils sont issus de familles de migrants mais ne sont pas migrants eux-m�mes; ils sont n�s e |