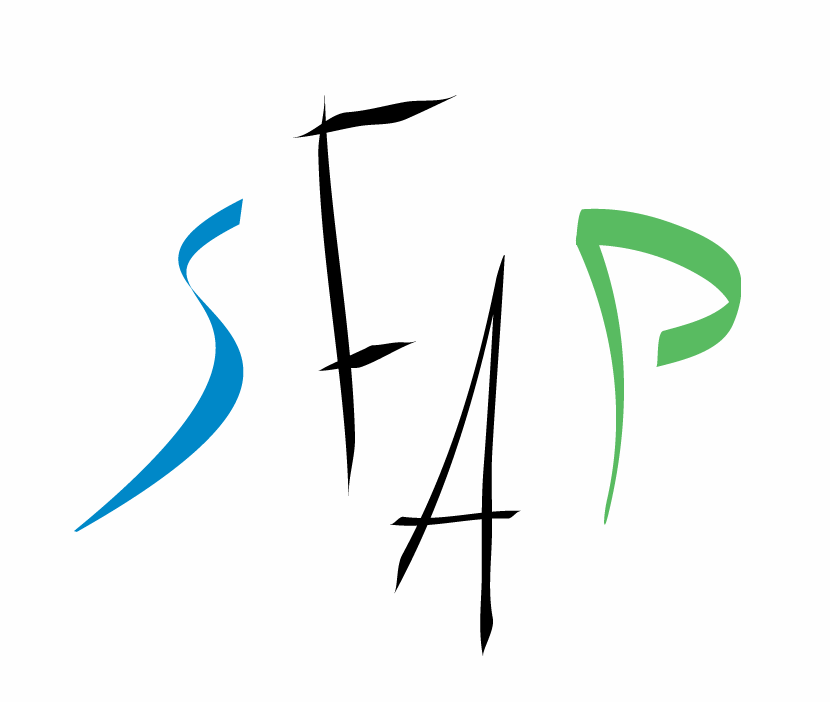Objectif 2�:
Compl�ment d�investigations cliniques et anthropologiques�:
Ici, il s�agit de faire des �tudes de cas
cliniques qui seront assur�es par des psychologues et un psychiatre pour tenter
de d�terminer un profil des personnes qui ont fait une TS. Nous avons �labor� un
protocole d�examen de TS qui aborde les ant�c�dents, les d�terminants et
conditions du passage � l�acte. Des entretiens cliniques et des tests (le
Rorschach) sont r�alis�s par les praticiens.
Objectif 3�: A
partir des r�sultats obtenus aux diff�rents niveaux, nous envisageons la
publication d�un ouvrage sur le suicide en Alg�rie
Objectif 4�: Projet
d�organisation de la prise en charge�:
Les axes pr�c�dents visent tous � mieux cerner
le profil des personnes qui font une TS et proposer ainsi un mod�le de centre de
prise en charge de suicidants et de soutien aux famille.

�
Le stress. Entre bien-�tre et souffrance
Berti Editions
Auteur : Mahmoud Boudarene
le stress est entre bien-�tre et souffrance, entre sant� et maladie. A ce
titre, il entre de plan pied dans le domaine de la m�decine et de la psychologie
m�dicale. Dans cette ouvrage, qui plaide en faveur d'une psychologie de la
sant�, l'auteur d�fend cette assertion et jette un �clairage sur les processus
par lesquels la vie et les �v�nements qui la parcourent , exercent une influence
sur la sant�.
Il utilise les donn�es scientifiques
actuelles, neurobiologiques, neuroendocrinologiques et neuropsychologiques pour
mieux faire comprendre le r�le de la vie psychique, interface entre
l'environnement ext�rieur et le sujet, dans l'�mergence de la maladie. Il met
ainsi en lumi�re les m�canismes par lesquels l'individu est conduit du " stress
de la vie " et de la faillite de ses strat�gies d'adaptation � la perte du
sentiment de bien-�tre et � la naissance de la souffrance et de la maladie.

La
Psychiatrie en Alg�rie par Farid Kacha

Souffrance au travail et Burn out
chez des agents de Police en exercice�: Une �tude pr�liminaire
Par le Dr
Mahmoud BOUDARENE , M�decin Psychiatre,
Docteur en Sciences Biom�dicales
Paru sur le Journal International de
Victimologie,
Ann�e 2, Num�ro 2,
Avril 2004
T�l�charger l'article (format
PDF)

Common
mental disorders in postconflict settings
Joop
T V M de Jong, Ivan H Komproe, Mark Van Ommeren
Research
into postconflict psychiatric sequelae in low-income
countries has been focused largely on symptoms rather than on full psychiatric
diagnostic assessment. We assessed 3048 respondents from postconflict
communities in
Algeria
,
Cambodia
,
Ethlopia, and
Palestine
with the aim of establishing the prevalence of mood disorder, somatoform
disorder, posttraumatic stress disorder (PTSD), and other anxiety disorders.
PTSD and other anxiety disorders were the most frequent problems. In three
countries, PTSD was the most likely disorder in individuals exposed to, violence
associated with armed conflict, but such violence was a common risk factor for
various disorders and comorbidity combinations in different settings. In three
countries, anxiety disorder was reported most in people who had not been exposed
to such violence. Experience of violence associated with armed conflict was
associated with higher rates of disorder that ranged from a risk ratio of 2-10
(95% CI 1.38-2.85) for anxiety in Algeria to 10.03 (5.26-16.65) for PTSD in
Palestine
.
Postconflict mental health programmes should address
a range of common disorders beyond PTSD.
Lancet 2003; 361 :
2128-30

634
schizophr�nes, 6 ans apr�s
1994
�
Y.
MERDJI Clinique de Psychiatrie et de Psychologie M�dicale, CHU de Constantine,
25000�CONSTANTINE (Alg�rie)
M.
TOUARI m�me adresse
B.
BENSMAIL " "
Objectifs
Il
s'agit d'appr�cier le devenir clinique et psycho-social, � moyen terme, d'une
population de schizophr�nes, diagnostiqu�s selon le DSM III-R, hospitalis�s
en 1988 � la Clinique de Psychiatrie et de Psychologie M�dicale du CHU de
Constantine.
Pour
les sujets ayant mal �volu�, on s'efforcera, autant que possible, d'identifier
les facteurs de mauvais pronostic.
M�thodologie
634
schizophr�nes, adultes des 2 sexes, diagnostiqu�s selon le DSM�III-R et
hospitalis�s entre le 1er janvier 1988 et le 31 d�cembre 1988 � la Clinique
de Psychiatrie du CHU de Constantine, ont �t� inclus dans une enqu�te �pid�miologique
longitudinale et prospective, entrant dans le cadre d'un projet de recherche sur
l'�volution des psychoses.
Un
questionnaire standard informatis� comportant 26 items est, apr�s validation,
exploit� par la m�me �quipe, en 1988, � l'inclusion, et en 1994, lors du
contr�le des patients.
La
fr�quence des r�admissions, dans la m�me structure d'accueil, entre 1989 et
1994 a �t� particuli�rement �tudi�e.
R�sultats
Sur
les 634 schizophr�nes initialement examin�s : 60% sont, soit en traitement
ambulatoire, soit consid�r�s comme "perdus de vue" ; 40% ont �t� r�admis,
au moins 1 fois (dont 7,7% l'ont �t� 4 fois et plus) ; par ailleurs 1,7% de
sujets (11 cas) sont d�c�d�s, dont le tiers environ (4 cas) par suicide.
Mots-clefs
Schizophr�nes
- Evolution - R�admissions
Publications
MERDJI
Y, TOUARI M, BENSMAIL B. 634 Schizophr�nes, six ans apr�s. Congr�s de
Psychiatrie et de Neurologie de Langue Fran�aise - LXXXXIIe Session - Toulouse,
13-17 juin 1994, comptes rendus � para�tre, Ed. Masson
�

1993-1994
M.
TALEB H�pital Louis Mourier, Service de Psychiatrie, 178 r des Renouillers,
92701 COLOMBES CEDEX
F.
ROUILLON Universit� Paris VII - H�pital Louis Mourier, Service de Psychiatrie,
178 r des Renouillers, 92701 COLOMBES CEDEX, T�l (1) 47.60.61.62 (poste 3580)
F.
PETITJEAN H�pital Ren� Dubos, Service de Psychiatrie, 95000 PONTOISE
�
Objectifs
Comparer
la clinique schizophr�nique de trois groupes de schizophr�nes (Fran�ais de
"souche" - "Beurs" et Alg�riens vivant en Alg�rie).
M�thodologie
Schizophr�nie
(18-35 ans) Crit�res DSM III-R.
N
= 30 par groupe (avec appariement �ge - sexe).
Echelles
SANS - PANS - BPRS - CGI - GAF.
R�sultats
Clinique
assez comparable dans les trois groupes (SANS - PANS et BPRS).
Modalit�s
�volutives des schizophr�nes maghr�bins vivant en France plus proches de
celles des schizophr�nes fran�ais d'origine que de celles des schizophr�nes
alg�riens vivant en Alg�rie.
Mots-clefs
Schizophr�nie
- Clinique transculturelle
�

L'organicit�
en milieu psychiatrique
1993
Y.
MERDJI Clinique de Psychiatrie et de Psychologie M�dicale du CHU de
Constantine, 25000�CONSTANTINE (Alg�rie)
A.
KHODJA m�me adresse
K.
BENSMAIL " "
R.
MANAMANI " "
M.L.
BENKARA-MOSTEFA " "
B.
BENSMAIL " "
Objectifs
Donner
un aper�u sur la nature de la pathologie organique, observ�e en milieu
psychiatrique.
Appr�cier
la qualit� de la prise en charge des malades mentaux pr�sentant une affection
somatique grave, par les services m�dico-chirurgicaux d'accueil.
M�thodologie
27
patients, hospitalis�s � la clinique de Psychiatrie et de Psychologie M�dicale
du CHU de Constantine, puis transf�r�s entre le 01/01/91 et le 31/12/92 (p�riode
de 2 ann�es) vers un service m�dico-chirurgical sont �tudi�s sur la base :
-
des registres de mouvements des malades (entrants, sortants, �vacu�s, transf�r�s,
d�c�d�s),
-
des dossiers m�dicaux (service de Psychiatrie, service d'accueil),
-
et d'une fiche de renseignements cliniques standard (20 items).
R�sultats
Signes
d'appel organiques (� l'admission en Psychiatrie) : pr�sents chez 20 malades,
absents ou m�connus chez 07 patients.
Services
d'accueil les plus sollicit�s : m�decine interne, r�animation m�dicale,
maladies infectieuses.
Affections
organiques les plus fr�quentes : insuffisance cardiaque, diab�te compliqu�,
�pilepsie avec signes de localisation, traumatismes.
Evolution
� court terme : 05 sortants, 19 retransf�r�s en Psychiatrie, 03 d�c�d�s
(enc�phalite c�r�brale, tumeur c�r�brale, h�matome sous-dural cons�cutif
� une TS).
La
c�l�rit� dans la prise en charge d�pend plus de rapports "personnalis�s"
que d'un sch�ma organisationnel institu�.
Mots-clefs
Organicit�
- Transfert - Services m�dico-chirurgicaux - Prise�en�charge
�

Devenir
� moyen terme d'une population de psychotiques hospitalis�s en 1988 �
Constantine
1993
Y.
MERDJI Clinique de Psychiatrie et de Psychologie M�dicale, CHU de Constantine,
25000�CONSTANTINE (Alg�rie)
N.
BENLATRECHE m�me adresse
K.
BENSMAIL " "
B.
BENSMAIL " "
Objectifs
L'objectif
essentiel de ce travail est d'appr�cier, l'�volution clinique et
psycho-sociale de 743 psychotiques, hospitalis�s en 1988 � la Clinique de
Psychiatrie et de Psychologie M�dicale du CHU de Constantine.
M�thodologie
Enqu�te
�pid�miologique longitudinale et prospective sur la base d'un questionnaire
standard informatis� comportant 26 items. Inclusion : 1� psychotiques (DSM
III-R) ; 2� hospitalis�s entre le 1er janvier 1988 et le 31 d�cembre 1988 �
la Clinique de Psychiatrie et de Psychologie M�dicale du CHU de Constantine ; 3��r�admis,
au niveau de la m�me institution psychiatrique, entre 1989 et 1993.
R�sultats
Sur
les 743 psychotiques initialement inclus : 1/3 (234 sujets) ont �t� r�admis,
dans les 5 ann�es suivantes.
Parmi
les psychotiques r�admis 4 fois et plus (47 cas) : 55% sont en traitement
ambulatoire, 40 sont hospitalis�s au moment de l'�tude et 2 patients �taient
d�c�d�s (suicides) ; les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que
les hommes � avoir �t� r�admises.
Mots-clefs
Psychotiques
- Evolution - R�admissions
�

Evaluation
de l'autonomie de 200 patients trait�s aux neuroleptiques � action prolong�e
1992
M.
BOUDEF Serv. Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie, H�pital
Psychiatrique Razi, 23000 ANNABA (Alg�rie), T�l 84.97.50
F.
GHOULI m�me adresse
Objectifs
L'autonomie
des patients psychotiques chroniques est un but principal dans la strat�gie th�rapeutique.
Dans cette �tude, nous tentons d'appr�cier cette autonomie sur diff�rents
aspects du v�cu de ces patients : social, familial et professionnel.
M�thodologie
Les
donn�es de l'�tude proviennent d'une base de donn�es plus g�n�rales
concernant les patients trait�s aux neuroleptiques retards � l'h�pital
psychiatrique de Annaba. L'�valuation de l'autonomie constitue un volet
important du suivi de ces patients.
La
m�thode d'�valuation est bas�e sur une cotation en cat�gories qualitative de
l'autonomie bonne, mod�r�e, mauvaise. Elle porte sur un aspect objectif
rapport� par la famille en ce qui concerne l'int�gration de la vie familiale
sociale et professionnelle et un aspect subjectif recueilli aupr�s du patient
et de sa famille sur cette autonomie.
R�sultats
Les
r�sultats montrent une bonne int�gration socio-familiale, 138 cas sur 200 soit
69% et le contraire en ce qui concerne la vie professionnelle 9 cas seulement
sur les 200 �tudi�s continuent � travailler.
L'impression
de la famille est satisfaisante. Pr�s de 50% des familles affirment �tre
satisfaites de l'autonomie acquise chez leurs patients.
L'impression
du patient sur son autonomie est �galement satisfaisante chez la moiti� de l'�chantillon.
Mots-clefs
Evaluation
- Autonomie - Psychose chronique - Neuroleptiques � action prolong�e
�

L'urgence
en psychiatrie
1992
B.
BENSMAIL Clinique de Psychiatrie et de Psychologie M�dicale du CHU de
Constantine, 25000 CONSTANTINE (Alg�rie)
Y. MERDJI m�me adresse
M. TOUARI " "
K. BENSMAIL " "
A. SAIDI " "
B. LARABA " "
Objectifs
Etudier
les caract�ristiques de l'urgence psychiatrique. Appr�cier son taux par
rapport � l'urgence m�dicale. D�finir le profil-type du patient pr�sentant
une urgence psychiatrique.
M�thodologie
Enqu�te
�pid�miologique r�alis�e � la Clinique de Psychiatrie et de Psychologie M�dicale
du CHU de Constantine du 1er octobre 1991 au 30 avril 1992, sur la base d'un
questionnaire informatis� comprenant 23 items. 2 lots de sujets sont particuli�rement
�tudi�s : - ceux pr�sent�s � l'unit� d'Urgences psychiatriques du CHU (664
cas), - et ceux admis en R�animation M�dicale pour tentative de suicide (116
cas).
R�sultats
Les
Urgences psychiatriques au CHU de Constantine repr�sentent 15% de la totalit�
des Urgences M�dicales. L'urgence psychiatrique se manifeste, le plus souvent,
par un �tat d'agitation psycho-motrice, chez une personne pr�sentant des
troubles psychotiques (71%), ou plus rarement des troubles affectifs (11%),
anxieux (9%), ou mentaux organiques (6%). Mieux prendre en charge l'urgence
psychiatrique, c'est aussi am�liorer et humaniser les conditions de transport
et l'accueil du malade et privil�gier l'intervention pluridisciplinaire.
Mots-clefs
Urgences
psychiatriques
Publications
Comptes
rendus du Congr�s de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Fran�aise, LXXXXe
Session, Saint-Etienne, 1992, 464-479, Ed. Masson.
�

Evaluation
de la scolarit� d'enfants issus de m�res en souffrance psychologique
1992 M. BOUDEF Serv. Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie, H�pital
Psychiatrique Razi, 23000 ANNABA (Alg�rie), T�l 84.97.50 M. BENSAIDA m�me
adresse
Objectifs
Le
but de l'�tude est de rechercher des anomalies du devenir scolaire d'enfants
issus de m�res en souffrance psychologique, par rapport � ceux issus de m�res
sans troubles manifestes et de tenter de corr�ler ces anomalies, si elles
existent au type de pathologie retrouv�e chez la m�re.
M�thodologie
La
m�thodologie se base sur une enqu�te transversale r�alis�e en 1992, aupr�s
de 100 m�res suivies en psychiatrie. Un questionnaire ferm� contient les items
socio-d�mographiques, cliniques et la situation scolaire de chaque enfant. Le m�me
questionnaire a �t� appliqu� � un groupe t�moin, appari� selon l'�ge et
les conditions socio-d�mographiques, de 50 m�res sans troubles psychiques
manifestes.
R�sultats
La
comparaison de la progression scolaire des deux groupes d'enfants ne pr�sente
aucune diff�rence significative. Les enfants �voluent sur le plan scolaire de
la m�me mani�re quel que soit le diagnostic, la gravit� de l'�volution chez
la m�re malade.
Mots-clefs
Enfants
de M�res schizophr�nes - Famille - Scolarit� - Population t�moin
�

Approchce
�pid�miologique des psychoses � travers l'Est Alg�rien
1990
Y.
MERDJI Clinique de Psychiatrie et de Psychologie M�dicale, CHU de Constantine,
25000�CONSTANTINE (Alg�rie)
Objectifs
D�finir
le profil �pid�miologique g�n�ral des Psychotiques hospitalis�s en donnant
un aper�u sur leur distribution quantitative, en fonction de crit�res
diagnostiques, anamnestiques, cliniques, psycho-sociaux, ...
Appr�cier,
si possible, les possibilit�s �volutives, observ�es � court et � moyen
terme.
Rechercher
s'il existe des crit�res discriminants pouvant pr�juger du devenir clinique
des sujets.
Juger
si certains param�tres sont suffisamment fiables pour appr�cier l'adaptation
psycho-sociale.
M�thodologie
Enqu�te
�pid�miologique descriptive, � la fois r�trospective et prospective, portant
sur les psychotiques (DSM III-R), adultes des 2 sexes, hospitalis�s entre le
1er janvier 1988 et le 31 d�cembre 1988 � la Clinique de Psychiatrie et de
Psychologie M�dicale du CHU de Constantine.
Les
variables anamnestiques, cliniques, diagnostiques, psycho-sociales et �volutives
concernant les 734 psychotiques inclus sont report�es sur une
fiche-questionnaire standard de 26 items et trait�es par informatique.
R�sultats
Sexe-ratio
: 3 hommes pour 1 femme.
Pr�s
de 75% des sujets sont �g�s de moins de 40 ans, seuls 13 patients ont plus de
60 ans.
84%
de schizophr�nies, 10% de troubles schizophr�niformes et 4% de troubles d�lirants.
Les
d�buts de psychose d'allure thymique, surtout maniforme, sont plus fr�quents
chez les femmes.
Les
dyskin�sies tardives invalidantes sont exceptionnelles.
Le
suicide est rare (4 cas).
Dans
65% adaptation bonne ou moyenne, dans 35% m�diocre ou mauvaise.
Mots-clefs
Psychoses
- Evolution - Facteurs de Risque - Pronostic
Publications
Th�se
de Doctorat en Sciences M�dicales, D�partement de M�decine, Constantine,
1990, 265 p.

Profil
�pid�miologique des urgences psychiatriques
1990
M.
BOUDEF Serv. Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie, H�pital
Psychiatrique Razi, 23000 ANNABA (Alg�rie), T�l 84.97.50
D. GHOUMA m�me adresse
S. BENNOUA " "
Objectifs
L'objectif
principal de l'�tude est de d�crire un �chantillon de consultants au niveau
de l'unit� Urgences de l'H�pital psychiatrique de Annaba.
M�thodologie
L'�tude
est de type prospective. Tous les patients examin�s au niveau des urgences par
le m�decin psychiatre de garde durant une p�riode de 03 mois (allant du
10/01/90 au 10/04/90) ont �t� inclus dans l'�chantillon. Pour chaque patient
l'enqu�teur remplit un questionnaire ferm� mentionnant les diff�rents param�tres
: socio-d�mographiques, cliniques et th�rapeutiques.
R�sultats
Le
profil de l'urgence psychiatrique � Annaba se pr�sente comme suit : - 69% de
sexe masculin, - 70% �g�s entre 20 et 40 ans, - plus de 50% viennent de la
ville si�ge de l'h�pital, - 72% viennent accompagn�s par des parents, - 68%
empruntent le taxi ou le bus pour arriver � l'h�pital, - 78% consultent le
jour, - 62% sont des anciens malades, - 56% pr�sentent un acc�s psychotique, -
le motif le plus fr�quent est l'�tat d'agitation.
Mots-clefs
Urgences
psychiatriques - Etude prospective
Publications
BOUDEF
M, GHOUMA D, BENNOUA S. Les urgences psychiatriques : Profil �pid�miologique.
Revue sant� plus, 1992, 15.
�

Evaluation
quantitative de la d�pression chez le sujet �g� en milieu institutionnel alg�rien
(Etude cas-t�moin)
1990
M.
BOUDEF Serv. Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie, H�pital
Psychiatrique Razi, 23000 ANNABA (Alg�rie), T�l 84.97.50
D.
GHOUMA m�me adresse
S. BENNOUA " "
Objectifs
Le
but de l'�tude est d'�valuer le v�cu d�pressif chez le sujet �g� en
placement dans une institution, comparativement au sujet �g� vivant en milieu
familial.
M�thodologie
La
population �tudi�e est compos�e de 85 sujets plac�s dans l'une des deux
institutions pour personnes �g�es que compte la ville d'Annaba. L'ensemble des
patients inclus (N=85) ont subi un entretien clinique men� par l'un de nous.
Une �valuation � l'aide de l'�chelle MADRS a �t� effectu�e. La population
t�moin a �t� recrut�e dans les lieux de rencontres habituels des personnes
�g�es, et particuli�rement les mosqu�es. Les deux populations sont appari�es
selon l'�ge et le sexe (N=50). La m�me d�marche d'�valuation a �t� appliqu�e
pour elles deux.
R�sultats
L'analyse
globale des r�sultats � la MADRS a montr� un score global moyen, sup�rieur
chez les sujets plac�s en institutions. La diff�rence est significative � p =
0,01.
Mots-clefs
D�pression
- Sujet �g� - Evaluation - Alg�rie - MADRS

L'appel
au psychiatre dans les services m�dico-chirurgicaux du CHU de Constantine
1989
B.
BENSMAIL Clinique de Psychiatrie et de Psychologie M�dicale du CHU de
Constantine, 25000�CONSTANTINE (Alg�rie)
Y.
MERDJI m�me adresse
N.
BENLATRECHE " "
Objectifs
Evaluer
et appr�cier le type de demandes en soins psychiatriques en �manant des
services m�dico-chirurgicaux du CHU de Constantine.
Identifier
les services les plus demandeurs et les motivations r�elles des appels.
Organiser
et d�velopper la psychiatrie de liaison au CHU de Constantine.
M�thodologie
Enqu�te
portant sur les appels inter-services r�ceptionn�s par le M�decin de garde de
la Clinique de Psychiatrie et provenant des divers services m�dico-chirurgicaux
du CHU de Constantine.
Dur�e
: 01 ann�e (avril 1988 - avril 1989).
Fiche-questionnaire
de 14 items.
67
appels enregistr�s concernant 62 malades (05 patients ayant �t� revus une
seconde fois).
R�sultats
Taux
de demandes infime : en moyenne 1,3 appels / semaine pour un CHU comptant 25
services d'hospitalisation, plus de 1600 lits et pr�s de 60.000 admissions /
an.
Paradoxalement,
les services qui sollicitent le moins l'aide du Psychiatre sont ceux o� pr�cis�ment
les r�percussions psychologiques et psychiatriques sont le plus fr�quemment
observ�es : P�diatrie, Dermatologie, Canc�rologie, Pneumophtysiologie, ...
A
travers l'appel, c'est souvent le transfert en Psychiatrie d'un patient qui
perturbe peu ou prou la discipline interne du service qui est implicitement
recherch�e.
Mots-clefs
Psychiatrie
de Liaison - Services m�dico-chirurgicaux - Confrontation Psychiatre-Somaticien
Publications
Comptes
rendus du Congr�s de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Fran�aise,
LXXXVIIe session, Montr�al, 3-9 juillet 1989, 277-288, Ed. Masson.

Troubles
psychiatriques en chirurgie cardiaque "� coeur ouvert" sous CEC
1988-1989
1991-1992
M.
BOUDEF Serv. Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie, H�pital
Psychiatrique Razi, 23000 ANNABA (Alg�rie), T�l�84.97.50
�
Objectifs
Apr�s
l'indication op�ratoire (sous CEC) par le cardiologue, les patients subissent
des tests psychologiques (MMPI, Rorschach).
Un
entretien psychiatrique aura lieu � deux reprises (T1 en soins intensifs
post-op�ratoires et T2 un mois apr�s la sortie).
Le
but est de recenser et quantifier les �ventuels accidents psychiatriques qui
surviennent au d�cours de ce type d'intervention chirurgicale.
M�thodologie
Une
anamn�se minutieuse permettra de rechercher des facteurs psycho-sociaux qui
peuvent �tre pr�pond�rants dans le d�clenchement de ces troubles psychiques.
Enfin,
une comparaison avec les travaux �trangers aura comme but d'identifier, s'il y
a lieu, des particularit�s cliniques ou �volutives en Alg�rie.
R�sultats
Sur
les 54 cas inclus dans l'�tude, 11 ont pr�sent� des troubles psychiatriques
post-op�ratoires, soit une fr�quence de 17%.
Dans
8 cas, les troubles ont �t� pr�coces, par contre les 3 autres cas ont �t�
tardifs.
Les
troubles pr�coces sont de nature psychotique aigue domin�e par les troubles de
la conscience et �mergence de th�mes d�pressifs et pers�cutoires.
Les
troubles tardifs sont de nature psycho-n�vrotique diff�rant significativement
(P 0,01) en ce qui concerne les ant�c�dents chirurgicaux, ainsi que la gravit�
de l'atteinte cardiaque.
Enfin,
la fr�quence des troubles se situe en position m�diane par rapport aux travaux
�trangers.
Mots-clefs
Troubles
psychiatriques - Chirurgie cardiaque - Circulation�extra�corporelle - Test
de Rorschach