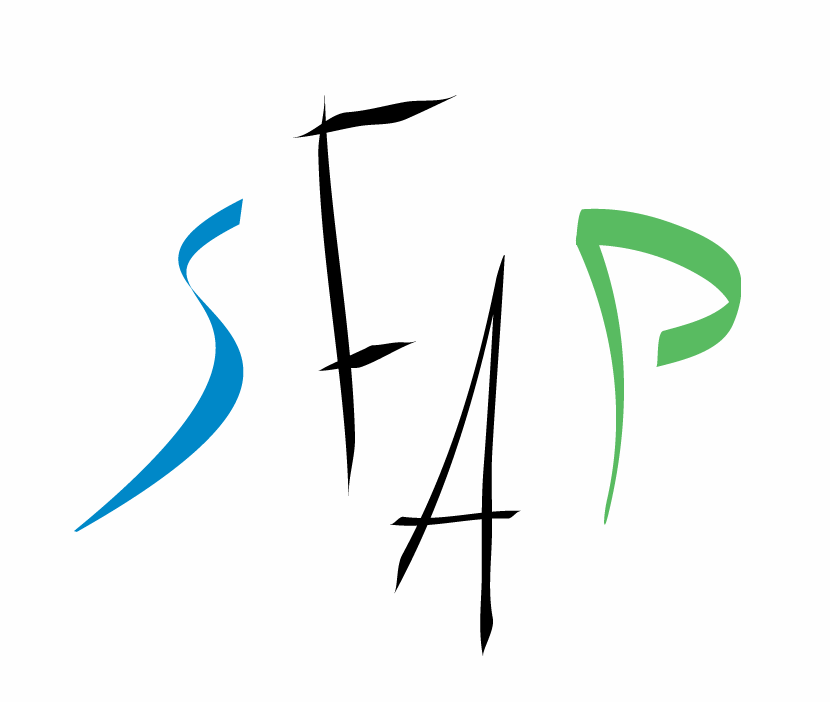
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE
|
SOCIETE FRANCO-ALGERIENNE DE PSYCHIATRIE |
|
� �Etude interculturelle de la Schizophr�nie. Comparaison de patients fran�ais autochtones et maghr�bins de seconde g�n�ration* M.
TALEB, F. ROUILLON, F. PETITJEAN, Ph. GORWOOD
�
* Etude parue dans Psychopathology:� "Cross-Cultural Study of
Schizophrenia" 1996; 29:85-94 INTRODUCTION Si l'�tude interculturelle des troubles psychotiques est ancienne (1), elle fut longtemps l'objet d'�laborations th�oriques au d�triment des approches �pid�miologiques interculturelles qui constituent pourtant un des abords essentiels � la compr�hension de l'influence culturelle sur le processus schizophr�nique. Elles supposent la r�alisation d'�tudes rigoureuses (2) et l'utilisation d'outils permettant une fiabilit� des comparaisons (crit�res diagnostiques, techniques de recueil des donn�es, �chelles d'�valuation psychopathologique...). De tr�s nombreuses strat�gies de recherche ont �t� utilis�es pour l'approche transculturelle des troubles mentaux. Parmi cette h�t�rog�n�it� m�thodologique, il convient de souligner que le recueil de donn�es peut se faire au niveau de centres g�ographiquement diff�rents ou � partir de populations de cultures diff�rentes vivant dans le m�me environnement social et �conomique (3). Cette derni�re situation est r�alisable du fait de l'implantation� dans certains pays de populations immigr�es d'origines ethno-culturelles diff�rentes de celle du pays d'accueil. ��������
L'implantation
en France d'une population d'origine maghr�bine est une des situations
susceptibles d'int�resser le chercheur pour des �tudes comparatives. En effet,
depuis quelques ann�es l'int�r�t des psychiatres s'est d�plac� des migrants
(4, 5, 6) vers les g�n�rations issues de la migration (7, 8, 9). Les sujets
dits "de seconde g�n�ration" donnent l'occasion d'entreprendre des
�tudes comparatives int�ressantes � plus d'un titre. Ils ont en principe acc�s
aux m�me structures de soins que les autochtones et peuvent, par exemple, �tre
�valu�s avec les m�mes instruments de mesure sans que se pose le probl�me de
la barri�re linguistique.
�����������
On entend par Maghr�bins "de seconde g�n�ration" les enfants
n�s de parents ayant migr� des pays du Maghreb vers la France et y r�sidant
encore (10). La plupart d'entre eux sont de nationalit� fran�aise. On les
appelle �galement les g�n�rations issues de l'immigration, les enfants de la
transplantation, les maghr�bins de France, les fran�ais d'origine maghr�bine,
les enfants post migrants, les enfants de la transculture et plus r�cemment les
"Beurs". Ces diff�rentes appellations traduisent une difficult�
certaine � d�finir d'une mani�re pr�cise cette population. Leurs parents
sont originaires des pays du Maghreb (Alg�rie, Maroc, Tunisie) et se sont
principalement install�s en France � la suite du flux migratoire des ann�es
soixante. La plupart de ces enfants sont n�s en France ou s'y sont install�s
tr�s jeunes. Le recensement de 1982 (8) estimait la population d'origine maghr�bine,
vivant en France, � pr�s de 1 800 000 personnes dont plus de 400 0000
adolescents.
�����������
Rappelons, enfin, que les pays du Maghreb sont relativement homog�nes
sur le plan ethno-culturel et social: on y parle les m�mes langues (arabe ou
berb�re), la religion musulmane y est pr�dominante, leur histoire et leurs
origines sont communes, les modes de vie et les structures sociales y sont
similaires... La situation en France des immigr�s originaires de ces pays est
�galement identique. Vivant pour la plupart, dans les m�mes ensembles sociaux,
occupant des situations professionnelles et �conomiques comparables, ils
subissent les m�mes difficult�s de l'existence.
�����������
De nombreux auteurs se sont r�cemment interrog�s sur l'identit� des
maghr�bins de deuxi�me g�n�ration. Si cette question fait encore l'objet de
d�bats, nous pouvons n�anmoins rep�rer trois �l�ments essentiels qui caract�risent
ces sujets :
�
Ils sont issus de familles de migrants mais ne sont pas migrants eux-m�mes; ils
sont n�s et ont grandi en France.
�
Ils sont d'origine ethnoculturelle maghr�bine. En effet ils ont �t� pour la
plupart �lev�s selon les principes �ducatifs de leurs parents.
�
Ils sont en situation transculturelle car pour int�grer et assimiler une partie
de la culture dominante et une partie de la culture parentale, ils doivent n�cessairement
refuser un peu de chacune d'elles (11).
�����������
Les patients schizophr�nes issus de ce groupe social subissent donc deux
ph�nom�nes: la situation transculturelle qu'ils vivent avec tous les probl�mes
identitaires que cela peut engendrer, le processus pathologique qu'ils pr�sentent
(la schizophr�nie) connu pour affecter profond�ment la perception de la r�alit�
par l'individu.
La
question qui se pose alors tout naturellement est de savoir si ces aspects d�terminent
chez ce groupe de patients des particularit�s cliniques, �pid�miologiques, �volutives
et pronostiques, du trouble dont ils souffrent.
�
�����������
Il s'agit d'une �tude transversale comparative de
patients schizophr�nes d'origines culturelles diff�rentes, �g�s de 18 � 35
ans.
�����������
1. Objectifs
�����������
�����������
Cette �tude se propose d'�valuer le trouble schizophr�nique chez des
patients maghr�bins "de deuxi�me g�n�ration" vivant en France, par
comparaison � des patients fran�ais autochtones et � des patients maghr�bins
vivant dans leur pays, l'Alg�rie.
�����������
Pour �valuer l'influence culturelle sur le trouble schizophr�nique,
trois groupes de 30 patients ont �t� recrut�s � partir des crit�res de
diagnostic du D.S.M. III-R.
�����������
2. Inclusion
�����������
Tous les patients, homme ou femme, �g� de 18 � 35 ans, r�pondant aux
crit�res diagnostiques de la schizophr�nie du DSM III-R et r�cemment
hospitalis�s dans un service de psychiatrie ont �t� inclus. Les enfants de
migrants maghr�bins vivant en France ayant le plus souvent moins de 35 ans, en
raison de la p�riode du grand flux migratoire des ann�es soixante, nous avons
choisi la tranche d'�ge des 18-35 ans afin de permettre un recrutement plus
homog�ne.
�����������
Les patients souffrant d'autres troubles psychotiques, de troubles
schizophr�niformes ou schizo-affectifs (au sens du DSM III-R) n'ont pas �t�
inclus dans l'�tude.
�����������
Trois groupes diff�rents de patients schizophr�nes ont ainsi �t�
constitu�s :
�����������
� un groupe (1) de patients maghr�bins "de seconde g�n�ration"
vivant en France ayant les caract�ristiques suivantes :
-
patients n�s en France ou y vivant depuis l'�ge de cinq ans (�ge de la
scolarit�)
-
ayant effectu� leur scolarit� en France
-
de parents n�s au Maghreb et vivant en France
-
langue maternelle des parents : l'arabe ou le berb�re
�����������
� un groupe (2) de patients fran�ais autochtones vivant en France
ayant les caract�ristiques suivantes :
-
patients n�s et vivant en France m�tropolitaine
-
scolarit� effectu�e en France
-
de parents n�s et vivant en France m�tropolitaine
-
langue maternelle des parents : le fran�ais
�����������
� un groupe (3) de patients maghr�bins vivant au Maghreb ayant les
caract�ristiques suivantes :
-
patients n�s et vivant au Maghreb
-
scolarit� effectu�e au Maghreb
-
de parents n�s et vivant au Maghreb
-
langue maternelle des parents : l'arabe ou le berb�re
�����������
3. Evaluation
�����������
Tous les patients sont �valu�s selon les m�mes proc�dures :���� �����������
�����������
� Donn�es socio-d�mographiques
�����������
Les param�tres classiques tels que l'�ge, le sexe, le niveau
d'instruction et la situation familiale ont �t� pris en compte. La situation
professionnelle actuelle a �t� �galement �valu�e. Nous avons fait une
distinction entre les patients qui ont d�j� travaill� et qui sont
actuellement au ch�mage, et ceux, sans emploi, qui n'ont jamais travaill�.
�����������
� El�ments anamnestiques
�����������
Deux param�tres ont �t� retenus pour �valuer la dur�e d'�volution
des troubles : la date de la premi�re consultation en psychiatrie et celle de
la premi�re hospitalisation.
�����������
Ces deux variables ont �t� choisies parce qu'ais�ment rep�rables. En
effet la date de la premi�re consultation est une donn�e plus objective que
celle beaucoup plus impr�cise de la date pr�sum�e du d�but des troubles ;
elle est souvent mentionn�e avec assez de pr�cision par les patients ou par
l'entourage. De m�me, la date de la premi�re hospitalisation traduit le moment
o� les troubles sont suppos�s avoir �t� assez importants pour n�cessiter
des soins � plein temps.
�����������
� Evaluation des sympt�mes
schizophr�niques
�����������
La standardisation des outils de mesure r�pond � un souci de rigueur
scientifique. Leur application � des �tudes interculturelles n'est pas
toujours facile. N�anmoins nous avons utilis� la traduction fran�aise des �chelles
d'Andreasen (12), l'�chelle d'�valuation de la symptomatologie n�gative,
"Schedule for the Assessment of Negative Symptoms "(SANS), et� l'�chelle d'�valuation de la symptomatologie positive,
"Schedule for the Assessment of Positive Symptoms" (SAPS).
L'utilisation de la SANS et de la SAPS dans leurs versions fran�aises ne pose
pas de probl�me avec les patients du Groupe 1 et 2 tous francophones. Il n'en
est pas de m�me avec les patients du Groupe 3, puisqu'il n'y a pas � notre
connaissance de versions en langue arabe. Cependant, l'Alg�rie est le deuxi�me
pays francophone dans le monde et le fran�ais est la seconde langue
administrative de ce pays. Mais l'utilisation d'�chelles non valid�es en
population maghr�bine constitue malgr� tout un biais in�vitable dans l'appr�ciation
et l'interpr�tation des r�sultats. N�anmoins, en dehors de quelques items,
les �chelles d'Andreasen privil�gient l'observation et �valuent des sympt�mes
ais�ment rep�rables. De surcro�t celui d'entre nous (M.T.) qui a conduit
l'ensemble des entretiens, en France et en Alg�rie, est bilingue.
�����������
Nous avons eu aussi recours � l'�chelle abr�g�e d'appr�ciation
psychiatrique (BPRS), souvent utilis�e pour l'appr�ciation clinique des
patients schizophr�nes. Elle permet l'�valuation d'un ensemble plus large de
sympt�mes accompagnant le trouble schizophr�nique, au-del� du clivage entre
signes n�gatifs et positifs. Cette �chelle comprend 18 items qui peuvent �tre
regroup�s en cinq facteurs (13) :
-
le facteur anxi�t�-d�pression comprenant les items suivants: pr�occupations
somatiques, anxi�t�, sentiments de culpabilit�, tendance d�pressive
-
le facteur anergie: retrait affectif, ralentissement moteur, �moussement
affectif, d�sorientation
-
le facteur troubles de la pens�e: d�sorganisation conceptuelle, m�galomanie,
comportement hallucinatoire, pens�es inhabituelles
-
le facteur activation: tension, mani�risme, excitation
-
le facteur hostilit�-suspicion: hostilit�, m�fiance, non-coop�ration.
�����������
Enfin, nous avons utilis� une CGI standard (Impression Clinique globale)
en sept niveaux et l'�chelle d'�valuation Globale du Fonctionnement (GAF) du
D.S.M.III-R qui appr�cie le fonctionnement psychologique, social et
professionnel (14). Son estimation se fait pour deux p�riodes actuelles: le
niveau de fonctionnement au moment de l'examen ou pour l'ann�e �coul�e (EGF1)
et le plus haut niveau de fonctionnement maintenu pendant au moins quelques mois
au cours de l'ann�e pr�c�dente (EGF2). Cette derni�re estimation ayant
souvent une signification pronostique.
�����������
4. Lieux de recrutement
�����������
Les patients des groupes 1 et 2 ont �t� recrut�s au sein de deux
services de psychiatrie de la r�gion parisienne. Ces deux services sectoris�s
couvrent des r�gions ayant une importante implantation maghr�bine. Les
patients du Groupe 3 ont �t� recrut�s en Alg�rie, dans deux services
hospitaliers diff�rents.
�����������
Tous les patients inclus dans l'�tude ont �t� �valu�s au cours d'une
hospitalisation, dans les jours qui suivent leur admission.
�����������
5. Analyse statistique
�����������
L'analyse a �t� men�e entre les trois groupes, puis d'une mani�re
distincte par groupe de deux si des diff�rences �taient constat�es.
�����������
Les m�thodes usuelles ont �t� employ�es : le test du
c2
pour les variables cat�gorielles avec correction de Yates quand cela �tait n�cessaire,
et les tests non param�triques de Mann-Whitney et de Kruskal-Wallis pour les
variables dimensionnelles. Les diff�rences statistiques avec un p<0.05 sont
consid�r�es comme significatives. Les r�sultats moyens sont pr�sent�s avec
l'�cart-type (ET) comme indice de dispersion. L'analyse porte sur le crit�re
principal en �valuant l'existence de diff�rences entre les groupes.
�
����������� 1- Population: Tableau N�1 �����������
- quatre-vingt-dix schizophr�nes (30 par groupe) ont �t� inclus dans
l'�tude ; 67 hommes et 23 femmes sans qu'aient �t� observ�e de diff�rence
significative de sexe ratio entre les trois groupes (c2 =
4.3, p=0.11).
�����������
L'�ge moyen du Groupe 1 est inf�rieur � celui des deux autres groupes.
Ceci est probablement en rapport avec les donn�es g�n�rales de l'immigration
maghr�bine qui a eu surtout lieu autour des ann�es soixante. Les enfants de
deuxi�me g�n�ration sont n�s pour la plupart en France et leur �ge est
souvent inf�rieur � 30 ans. L'�ge moyen des trois Groupes diff�re donc
significativement (p=0.01); il y a une diff�rence significative entre les
Groupes 1 et 2 (p=0.02) et entre les Groupes 1 et 3 (p=0.007); en revanche il
n'y en a pas entre les Groupes 2 et 3 (p=0.82).
�����������
- Le nombre d'analphab�tes (ne sachant ni lire ni �crire) du Groupe 3
est en rapport avec la situation de la scolarisation en Alg�rie. Le taux
d'analphab�tisme dans ce pays pour la population �g�e de plus de dix ans est
estim� � 42.7% (15). La r�partition selon les niveaux scolaires pour les
Groupes 1 et 2 est sensiblement identique.
�����������
La situation professionnelle est souvent consid�r�e comme un �l�ment
de pronostic ou du moins d'adaptation sociale. Elle est caract�ris�e par une
meilleure distribution chez les fran�ais autochtones. L'absence de couverture
sociale en Alg�rie explique l'absence dans le Groupe 3 de patients b�n�ficiant
d'une pension d'handicap� ou d'une aide sociale. En France les patients dans
l'incapacit� d'exercer un emploi per�oivent une allocation mensuelle. Les sans
emploi (ceux qui n'ont jamais travaill�) sont en majorit� dans le groupe 3
(90%). En Alg�rie le taux de ch�mage est estim� � plus de 25%, atteignant
d'ailleurs 63.5% pour la tranche d'�ge 16-19 ans (16).
����������� 2- Diagnostics Tableau N�2 �����������
La forme parano�de est sur repr�sent�e dans les deux premiers groupes
(56 % et 60 %) alors qu'elle ne repr�sente qu'un tiers des patients du 3�me
groupe (37 %).
En
revanche, les modalit�s �volutives des patients des groupes 1 et 3 sont plus
homog�nes, alors que celles du groupe 2 s'av�rent diff�rentes, notamment par
l'importante proportion de formes chroniques avec exacerbation aigu�.
Pour
autant aucune diff�rence statistiquement significative n'est retrouv�e, entre
les trois groupes, ni pour les types cliniques (p = .29) ni pour les modalit�s
�volutives (p = .39).
�����������
3- Evolution des troubles
�����������
Le temps moyen �coul� (en mois) depuis la premi�re consultation est de
55 (�57)� pour le Groupe 1, de 81 (�51)
mois pour le Groupe 2 et de 81 (�59) mois pour le Groupe 3. La diff�rence �tant
significative entre les trois groupes (p=0.03).
�����������
Le temps moyen �coul� (en mois) depuis la premi�re hospitalisation est
de 46 (�58) mois pour le Groupe 1, de 74 (�55) mois pour le Groupe 2 et de 69
(�63) mois pour le Groupe 3 ; la diff�rence �tant statistiquement
significative entre les trois groupes (p=0.03).
�����������
L'intervalle moyen (en mois) entre la premi�re consultation et la premi�re
hospitalisation est de 8.8 (�19) mois pour le Groupe 1, de 6.7 (�15) mois pour
le Groupe 2 et de 12.7 (�26) mois pour le groupe 3. Il n'existe pas de diff�rence
significative entre les trois groupes (p=0.67).
�����������
Le nombre moyen d'hospitalisations et la dur�e totale moyenne (en mois)
de s�jour � l'h�pital sont respectivement de 3.5 (�3.3) et 4.3 (�6) mois
pour le Groupe 1, de 5 (�3.6) et 9 (�13) mois pour le Groupe 2 et de 5 (�4)
et 5.7 (�6) mois pour le Groupe 3.
�����������
Il n'y a pas de diff�rence significative entre les trois groupes pour le
nombre moyen d'hospitalisation (p=0.10). En revanche, pour la dur�e totale
moyenne de s�jour � l'h�pital, on retrouve une diff�rence significative
entre les trois groupes (p= 0.002), les patients du Groupe 2 restant plus
longtemps � l'h�pital.
�����������
4- Traitement neuroleptique
�����������������������
Groupe 1
��������
Le nombre moyen de
neuroleptiques prescrits est de 1.9 (�0.5); 21 patients (70%) recevant deux
neuroleptiques. Les neuroleptiques les plus prescrits sont l'Halop�ridol (N=16,
dose moyenne � 13.6 (�5) mg/j), la chlorpromazine (N=10, dose moyenne � 245 (�121)
mg/j) et la cyam�mazine (N=10, dose moyenne � 136 (�175) mg/j). Neuf patients
(30%) re�oivent un neuroleptique � action prolong�e (NAP). Dans 70% des cas
(N=21) un traitement anti-parkinsonien est associ�.
�����������������������
Groupe 2
�����������
Le nombre moyen de neuroleptiques prescrits est de 2 (�0.6); 19 patients
(63%) recevant deux neuroleptiques. Les neuroleptiques les plus prescrits sont :
l'halop�ridol (N=20, dose moyenne � 21.4 (�15) mg/j), la cyam�mazine (N=10,
dose moyenne � 162.5 (�77) mg/j) et la chlorpromazine (N=6, dose moyenne �
208.3 (�155) mg/j).� Un NAP est
prescrit � 5 patients (16%). Dans 67% (N=20) des cas un anti-parkinsonien est
associ�.
�����������������������
Groupe 3
�����������
Le nombre moyen de neuroleptiques prescrits est de 2.2 (�0.5); 22
patients (73%) recevant deux neuroleptiques. Les neuroleptiques les plus
prescrits sont l'halop�ridol (N=17, dose moyenne � 14.2 (�6) mg/j), la l�vom�promazine
(N=16, dose moyenne � 294 (�147) mg/j), et la chlorpromazine (N=7, dose
moyenne � 250 (�96) mg/j). Seize patients�
(53%) re�oivent un NAP. Treize patients (43%) re�oivent un
anti-parkinsonien.
�����������
Les trois groupes ne pr�sentent pas de diff�rences significatives pour
le nombre moyen de neuroleptiques prescrits (p=0.24).
�����������
5. Utilisation d'une substance
psycho-active
�����������
L'utilisation d'une substance psycho-active (crit�res DSM III-R) a �t�
syst�matiquement recherch�e.
�����������������������
Groupe 1: Elle a �t� retrouv�e chez 11 patients (37%) dont 7 cas d'abus
de cannabis et 4 cas d'abus de psychotropes.
�����������������������
Groupe 2 : Elle est retrouv�e chez 8 patients (27%) dont 4 cas d'abus
d'alcool, 1 cas d'abus de coca�ne, 1 cas d'abus de cannabis et 2 cas d'abus de
m�dicaments psychotropes.
�����������������������
Groupe 3 : 5 patients (17%) pr�sentent un abus d'une substance
psycho-active dont 1 abus d'alcool, 1 abus de cannabis et 3 abus de m�dicaments
psychotropes.
�����������
L'utilisation d'une substance psychoactive, bien que sur repr�sent�e
dans le premier groupe et � un moindre degr� dans le second ne s'av�re pas
statistiquement diff�rente entre les trois groupes (p=0.21).
�����������
6. Ant�c�dents de tentatives de
suicide
�����������������������
Groupe 1 : Sept patients (23%) ont d�j� commis une tentative de
suicide (une seule dans leurs ant�c�dents). Le nombre moyen de tentatives �tant
de 0.2 (�0.4) par patient.
�����������������������
Groupe 2 : Treize patients (43%) ont commis une ou plusieurs tentatives de
suicide dans le pass�, le nombre moyen de tentatives �tant de 0.9 (�1.4) par
patient.
�����������������������
Groupe 3 : La notion d'une� tentative
de suicide n'est retrouv�e que chez 3 patients (10%) avec un nombre moyen de
tentatives de 0.2 (�0.9) par patient.
����������� 7. Symptomatologie Tableau N�3 (SANS et SAPS) Tableau N�4 (BPRS) �����������
Les trois groupes sont comparables tant pour les scores globaux moyen que
pour les scores moyens aux diff�rents facteurs de la SANS et de la SAPS. Pour
la BPRS si les scores moyens des diff�rents facteurs sont comparables pour les
trois groupes, les scores globaux sont statistiquement sup�rieurs dans les
groupes 1 et 2 par rapport au 3 (p < .03).
�����������
Toutefois, la comparaison des scores moyens de tous les items de l'�chelle
BPRS, entre les trois groupes, montre que seuls deux d'entre eux diff�rent
significativement, l'item Anxi�t� et l'item Ralentissement moteur plus �lev�s
dans les deux premiers groupes par rapport au troisi�me (p < .02 et p <
.002). En effet, pour l'item anxi�t� le score moyen n'est pas diff�rent
significativement entre le Groupe 1 et 2 (p = 0.33) ni entre les Groupes 1 et 3
(p = 0.10) mais il y a une diff�rence significative entre les groupes 2 et 3 (p
= 0.006). Enfin, pour le score moyen de l'item ralentissement moteur, il
n'existe pas de diff�rence significative entre les Groupes 1 et 2 (p=0.79); il
existe en revanche une diff�rence significative entre les Groupes 1 et 3
(p=0.002) et entre les Groupes 2 et 3 (p=0.002).
�����������
- De m�me aucune diff�rence statistiquement significative n'a �t�
retrouv�e entre les trois groupes (c2=9.2,
p=0.16) pour les scores � l'�chelle d'investigation clinique globale (CGI).
�����������
En
revanche, les scores moyens � l'�chelle globale du fonctionnement (EGF) dans
l'ann�e �coul�e sont statistiquement sup�rieurs (p < .01) dans le groupe
1 (49,3 � 13.3) et dans le groupe 2 (48,3 � 12,4) par rapport au troisi�me
groupe (39,2 � 14,4). Les scores des patients des trois groupes pour le
fonctionnement actuel ne sont n�anmoins pas statistiquement diff�rents
(respectivement 32,8 � 7,8; 35,1 � 10,4 et 29,4 � 10,4). Toutefois ce score
traduit la situation clinique lors de l'hospitalisation. Le score de l'EGF �valuant
le plus haut niveau de fonctionnement durant l'ann�e �coul�e est, � cet �gard,
plus int�ressant, car il peut avoir une signification pronostique. Il tient
compte � la fois de l'intensit� des sympt�mes, de la qualit� des relations
sociales et de la capacit� � avoir ou � maintenir une activit�
professionnelle. La diff�rence significative observ�e entre les scores moyens
� l'EGF, pendant l'ann�e �coul�e, objective que les patients vivant au
Maghreb ont un plus mauvais fonctionnement que ceux des deux groupes qui vivent
en France. En effet il n'existe pas de diff�rence significative pour ce score
entre les groupes 1 et 2 (p=0.80) alors que leurs scores moyens diff�rent
significativement d'une part entre les groupes 1 et 3 (p=0.01) et d'autre part
entre les groupes 2 et 3 (p=0.01).
�����������
Le "sex ratio" (homme/femme) est de 6,5/1 dans le groupe 1, de
1,73/1 dans le groupe 2 et de 2,75/1 dans le groupe 3. Des r�sultats similaires
sont souvent retrouv�s dans les �tudes �pid�miologiques du Maghreb (17, 18,
19). L'explication g�n�ralement donn�e met en avant les habitudes culturelles
qui offrent une vie publique plus r�duite � la femme, celle-ci �tant donc
moins susceptible de consulter que l'homme (20). Cependant, on peut se demander
comment cette caract�ristique peut se maintenir en situation de migration .
�����������
Parmi le Groupe de patients maghr�bins vivant en France un seul patient
(3%) est actif alors que pr�s de 27% de celui des autochtones le sont. De fait,
les donn�es sur le ch�mage en France montrent que celui-ci atteint d'une mani�re
plus importante les personnes d'origine �trang�re. Par ailleurs, l'Alg�rie et
la France ont des situations socio-�conomiques diff�rentes et ceci est un �l�ment
important dont il faut tenir compte dans l'analyse des donn�es. L'Alg�rie vit
actuellement une situation �conomique pr�caire et le ch�mage atteint plus du
quart de la population active compos�e en majorit� des moins de 25 ans; de
surcro�t le taux de scolarisation est relativement faible. L'ensemble de ces
facteurs �conomiques retentit n�cessairement sur la situation des patients
vivant dans ce pays et explique que 27 % d'entre eux soient analphab�tes et que
90% d'entre eux n'aient jamais travaill�. Il faut aussi noter qu'il n'existe
pas de mesures de protection sociale et aucun patient de ce dernier groupe ne b�n�ficie
d'une pension d'invalidit� ou d'une aide sociale. Toutefois, il est
classiquement reconnu qu'au Maghreb les malades b�n�ficient d'un r�seau de
soutien familial et d'une� tol�rance qui r�duit les effets de leurs difficult�s �conomiques.
�����������
La dur�e d'�volution des troubles est difficilement comparable entre
les groupes 1 et 2 compte tenu des diff�rences de leurs moyennes d'�ge.
Cependant l'intervalle entre les dates de premi�re consultation et de premi�re
hospitalisation ne pr�sente pas de diff�rence statistique entre les trois
groupes.
�����������
Le nombre d'hospitalisation ne diff�rent pas significativement entre les
trois populations tandis que le temps moyen pass� � l'h�pital est plus
important pour le groupe des fran�ais autochtones. Il est de 4 mois pour le
groupe 1 et de 9 mois pour le groupe 2. Ce r�sultat doit �tre cependant
relativis�, les patients maghr�bins de France �tant sensiblement plus jeunes.
Quant � la dur�e d'hospitalisation en Alg�rie elle est trop influenc�e par
les caract�ristiques des structures de soins de ce pays pour avoir une valeur
comparative.
�����������
L'utilisation d'une substance psycho-active retrouv�e exclusivement sous
forme d'abus et non de d�pendance, a une fr�quence comparable dans les trois
groupes. La diff�rence ne concernant que les produits utilis�s. L'utilisation
du cannabis est classiquement plus fr�quente chez les maghr�bins et celle
d'alcool chez les fran�ais.
�����������
La prescription de neuroleptiques est assez uniforme entre les diff�rents
groupes ainsi que le nombre de neuroleptiques et les posologies prescrites. La
diff�rence se situe dans l'observance du traitement, les deux groupes de maghr�bins
prenant moins r�guli�rement leur traitement. Le m�dicament psychotrope est fr�quemment�
per�u au Maghreb comme une drogue et explique les r�ticences de
certains patients � poursuivre r�guli�rement leur traitement. De plus,
l'insuffisance des structures sanitaires en Alg�rie, ne permet pas une prise en
charge totalement efficace en ambulatoire ce qui est � l'origine de nombreux
abandons de traitement. Ceci explique pourquoi plus de la moiti� des patients
du groupe 3 ont re�u des neuroleptiques � action prolong�e.
����������� La r�partition par type de schizophr�nie et par forme �volutive ne pr�sente pas de diff�rence significative entre les trois groupes; la forme parano�de �tant la plus repr�sent�e dans les trois groupes. De m�me aucune diff�rence entre les groupes n'est retrouv�e � la SANS et � la SAPS qui �valuent des dimensions cliniques symptomatiques du trouble schizophr�nique (retrait ou pauvret� affective, pauvret� de la pens�e et du discours, apathie et retrait social, id�es d�lirantes et hallucinations). Ces sympt�mes sont au c�ur m�me de la pathologie schizophr�nique et en constituent le noyau commun tel qu'il fut identifi� par l'Etude Pilote Internationale sur la Schizophr�nie men�e par l'O.M.S (21). L'absence de diff�rence entre les groupes concerne non seulement les scores globaux � la SANS et � la SAPS mais �galement l'ensemble des dimensions s�m�iologiques les composant ce qui sugg�re que l'environnement culturel et social n'influence pas de mani�re d�terminante les aspects cliniques fondamentaux de la maladie.
�����������
La distinction entre expression clinique et pronostic social d'une
maladie est souvent affirm�e. Elle permet d'op�rer une diff�rence entre
l'intensit� des manifestations d'un trouble et ses cons�quences sociales.
Ainsi, dans l'Etude Pilote Internationale sur la Schizophr�nie (EPIS) c'est la
dur�e d'hospitalisation qui a �t� retenue comme crit�re de r�insertion
sociale (22) alors que dans notre travail, il a �t� tenu compte du niveau
global de fonctionnement �valu� par l'EGF. Or, � la diff�rence de l'EPIS
notre �tude montre que les patients des deux groupes vivants en France (pays d�velopp�)
pr�sentent un meilleur fonctionnement que ceux vivant en Alg�rie (pays en voie
de d�veloppement). Les cons�quences sociales du trouble schizophr�nique
paraissent donc plus d�pendre de l'influence de l'environnement social que de
l'origine ethnoculturelle. Les Maghr�bins de France ont en effet un pronostic
de leur trouble plus proche de celui des autochtones que de celui des patients
vivant en Alg�rie. Les facteurs �conomiques sont sans doute plus d�terminants,
la situation socio-�conomique difficile d'un pays frappant principalement les
personnes souffrant d'un trouble mental.
�
IV - CONCLUSIONS�����������������������
����������� Cette �tude a montr� que pour les sympt�mes �valu�s, les patients schizophr�nes d'origine maghr�bine ne pr�sentent que peu de diff�rences cliniques par rapport aux patients d'origine fran�aise. Cette absence de diff�rence concerne principalement les "sympt�mes fondamentaux" de la schizophr�nie. L'origine culturelle ne semble donc pas d�terminer des diff�rences s�m�iologiques majeures. Ces r�sultats rejoignent ceux de l'EPIS qui concluait en ce sens, avec toutefois une comparaison plus large au niveau international. En dehors des aspects fondamentaux de la maladie, il serait n�anmoins utile de s'interroger sur des �l�ments symptomatiques g�n�ralement consid�r�s comme accessoires ou du moins peu sp�cifiques de la schizophr�nie. L'exploration de telles dimensions devrait �tre abord�e par de nouvelles proc�dures m�thodologiques multidisciplinaires, faisant notamment intervenir des m�thodes d'observation anthropologiques et sociologiques. �����������
Les probl�mes socio-�conomiques propres aux populations de migrants,
parfois plus que l'environnement culturel, interviennent pour souligner des diff�rences.
En effet, le niveau �conomique du milieu influence incontestablement la qualit�
globale de fonctionnement et d'adaptation sociale du patient schizophr�ne.
Ainsi, en Alg�rie, l'environnement culturel classiquement reconnu comme
favorable et tol�rant vis � vis de la maladie mentale c�de le pas aux
difficult�s �conomiques.
�
|